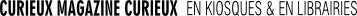


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


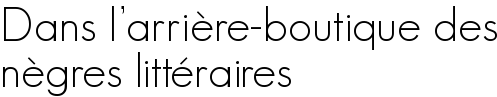
 |
|
|
Publié dans le
numéro 013 (Janv.-fév. 2012)
|
Ils ont la peau blanche, mais on les appelle des «nègres» : ils écrivent les livres des autres. À eux trois, ils ont dû écrire près de cent livres signés par d’autres noms que les leurs. Comme à son habitude dans cette rubrique, Le Tigre a modifié certains détails permettant d’identifier les personnes citées.
Propos recueillis pas Raphaël Meltz.
- On peut peut-être démarrer par la façon dont vous avez commencé ce métier un peu particulier.
Stéphane - Je ne connais pas de petit enfant, ni moi ni personne, qui, lorsqu’il a cinq ans, dise : « moi, je veux faire nègre dans la vie ».
Billie - Ça, c’est un bon démarrage. Moi je ne me suis pas dit non plus « je veux être nègre dans la vie ». En soi, c’est pas une ambition.
Stéphane - Adolescent, con comme j’étais, on m’aurait dit ça j’aurais répondu : « surement pas, jamais ! »
Billie - Tu voulais faire quoi, alors ?
Stéphane - Je voulais être écrivain.
Anne-Laure - Ah oui ?
- Anne-Laure, toi, c’est différent ?
Anne-Laure - Disons que je voulais écrire. J’adorais écrire.
- Mais pas de la fiction ?
Anne-Laure - Pas du tout. Enfin, il y avait forcément un désir, mais il y avait un interdit. Mes parents m’avaient dit : « mais, maudite, ça ne va pas, tu ne vas pas être artiste, comment tu vas manger, ce n’est pas un métier, et cætera ». C’était un péché d’écrire de la fiction.
- Donc tu t’es dit : il faut que je trouve un autre moyen de faire ce métier-là, d’écrire ?
Anne-Laure - Exactement. Il faut que je trouve à écrire en étant payé. Ça été les premiers livres que j’ai fait, des témoignages d’anonymes.
- Mais pourquoi s’empêcher d’être écrivain ?
Anne-Laure - Pour moi, écrivain c’était : tu meurs de faim, tu deviens fou, et tu finis alcoolique dans un grenier.
Billie - Edgar Poe, en gros.
Stéphane - C’est très vrai, ça, en plus. Ça continue d’être parfaitement vrai.
Billie - Oui.
Anne-Laure - Bien sûr !
Stéphane - Je connais plein d’écrivains qui, en vingt ans, ont tourné misère. Des gens qui sont morts, j’en connais plein. Des potes à moi qui écrivaient et qui sont morts, il y en a plein. Morts de marasme et de misère ! Ce n’est quand même pas très commun, en l’an 2000.
Billie - On est toujours au XIXè, en fait.
- Et toi, Stéphane, comment tu as commencé ?
Stéphane - Moi, je n’avais jamais pensé à faire ce métier. Je n’y étais pas hostile, mais je n’y avais jamais pensé. Un jour, mon téléphone sonne, j’étais journaliste, c’était un grand éditeur qui me dit : « on va faire le livre de H. [star de la télévision], je voudrais que ce soit vous ». Parce que j’avais écrit sur elle dans mon journal. « Vous allez gagner 150.000 francs, il faut que ce soit fini en quatre semaines. » Comme jamais personne ne m’avait proposé de gagner 150.000 francs en quatre semaines, je lui ai dit : « très bien, je vais peut-être m’arranger avec mon rédacteur en chef, je vais trouver trois semaines de vacances. Il faut faire ça où ? » « À Saint-Tropez. » « Très bien. » (rires)
- Donc c’est arrivé par accident ?
Stéphane - Oui. Enfin, l’éditeur avait pensé à moi. Et ce n’était pas n’importe qui. Il avait toujours du nez. Il a bien fait, d’ailleurs...
Anne-Laure - Moi, c’est le regret de ma vie, H. Le regret de ma vie.
Stéphane - Je comprends. Parce que moi, j’ai adoré ça. Vraiment.
- Mais Anne-Laure, toi tu as fait D. [top-model, star mondiale].
Anne-Laure - Ça n’a rien à voir !
Billie - Moi je n’en ai aucun de ce registre-là...
Stéphane - Ça, ce sont mes bases. Mais j’avais eu une carrière de romancier, avant. On ne peut même pas dire que ça se soit mal passé, parce que mes deux premiers livres ont eu des prix assez prestigieux. J’ai fait un troisième livre, qui n’a pas du tout marché. Et j’ai fait un petit solde. Je me suis dit : « mon Dieu, je me lève et je me couche avec un livre, avec une obsession de roman, ma vie passe entièrement là-dedans, ça photocopie tout. Je peux écrire la nuit, et me lever à cinq heures de l’après-midi. Tout le monde me voit comme un écrivain. Je vends 1350 livres. Je dépends du bon vouloir de grands bourgeois, de mécénat, de petits chèques qu’on récupère. » J’avais envie de vivre plein de choses, j’avais du goût pour le journalisme, pour la mondanité, pour les voyages, pour le dessin. J’étais un être assez léger. Je voyais l’état dans lequel je me mettais quand j’écrivais, et je me suis dit : « mais tu vas foutre ta vie en l’air ! » J’ai eu cette espèce de peur... J’aurais pu assumer une carrière littéraire. Mais je voyais, pour que la page soit bonne, pour que ça fonctionne, que ça vaille le coup d’être lu, l’état dans lequel je devais me mettre, la vie que ça impliquait pour moi. Je n’en ai qu’une, je ne veux pas vivre ça ! Je n’ai aucune aigreur, aucun regret : j’ai vécu des grandes joies dans l’écriture, mais je me suis dit « ça va me ratatiner ».
- Donc renoncer à la vie d’écrivain, qui est une vie (ironique) de la tristesse, de la souffrance... Mais écrire quand même ?
Stéphane - En termes de stratégie, je n’avais rien prévu. Si l’éditeur ne m’avait pas appelé, je ne serais peut-être jamais devenu nègre. La vie s’organise en fonction de. Après, j’ai gagné de l’argent. Et l’aventure de l’argent, c’est que, la deuxième année, le fisc sonne, et devant le fisc on ne peut pas redevenir un poète, parce que le fisc vous dit : « si vous ne gagnez pas autant d’argent l’année prochaine, on va venir saisir le tapis... » Tapis, que j’ai acheté... Et... (il montre le tapis du bureau du Tigre) qui est mieux que celui-là.
- J’imagine. J’espère ! (rires)
Anne-Laure - Je pense que, avant le fisc, un truc très concret, c’est que sans un minimum de sécurité matérielle, tu ne peux pas écrire. Ton rêve d’écrivain, si tu es en train de crever la dalle...
Billie - Ça, je ne suis pas forcément d’accord.
- (à Anne-Laure) Ça veut dire que tu ne mets pas l’art au-dessus de tout le reste... Tu t’opposes à la figure de l’écrivain maudit, qui met l’art au-dessus de tout.
Stéphane - Mais il est maudit...
Anne-Laure - Moi, je n’ai pas cette morale. Je ne mets rien au-dessus de rien.
Billie - Oui, mais l’écrivain maudit, il est égocentrique et paranoïaque.
Stéphane - Il est insupportable.
Billie - Il se dit que le monde est contre lui, que personne ne le comprend. Dans la démarche du nègre, il y a l’idée que le monde existe autour de soi, que les autres sont intéressants. Il y a un truc d’altruisme, et d’amour de l’autre, et de dissolution dans l’autre.
- Chez toi, Anne-Laure, il y a ça aussi ? L’intérêt pour l’autre ?
Anne-Laure - Complètement. Il vaut mieux, d’ailleurs. Si tu n’aimes pas l’autre, tu ne peux pas te faire chier autant.
- Et toi, Billie ?
Billie - Moi, mon parcours est presque à l’inverse de celui de Anne-Laure. Alors, oui, j’ai toujours aimé écrire. Je gagnais les concours de poésie à l’école, c’était clair que j’étais très littéraire. Par contre, j’ai vite été négative et pessimiste dans ma perception du monde, bon je lisais un peu trop Schopenhauer, et, à quinze ans, j’ai renoncé à l’idée d’être écrivain, en me disant : « ça ne sert à rien. Ce que j’ai à dire n’intéresse pas les autres. De toutes façons, aujourd’hui l’édition, c’est n’importe quoi, on publie tout le monde, ça n’a plus de sens. En plus je ne boufferai pas en étant écrivain. » Donc, je passe les détails, je suis devenue journaliste, et cætera, et puis je me retrouve à bosser dans une maison d’édition. Je m’occupais de la presse dans cette maison d’édition, on était très offensif avec les médias, on sortait beaucoup de livres assez chauds. Et, un jour, le patron, qui me connaît très bien, qui sait ce que j’écris, qui parle littérature avec moi alors qu’il parle politique avec les autres, me fait une proposition : il y avait P., une fille qu’on avait vue à la télé, parce qu’elle était avec T. [chanteur à scandale], et mon patron me dit : « elle veut faire un bouquin, j’aimerais bien que tu l’écrives ». Moi : « pour raconter quoi ? Un truc que tout le monde a vu à la télé ? Tout le monde s’en tape. » Il me dit : « rencontre-la quand même ». Je rencontre P., et, très rapidement, je me rends compte que la fille est loin d’être conne, et qu’elle est restée cinq ans avec T. pour se faire pourrir. Je me dis : « il y a un truc », ça commence à m’intéresser. Et, en discutant avec elle, je me rends compte qu’il y a une espèce de déterminisme, ses parents ont émigré d’Afrique à cause d’une guerre civile, elle s’est pris des poings sur la gueule à l’époque, et elle a reproduit ça avec T., une espèce de chaîne de l’esclavage. Je retourne voir mon patron, je lui dis : « écoute, je veux bien faire ton bouquin, mais par contre, T., je l’utiliserai dans le bouquin, mais ce n’est pas ça le fond, tu me laisses l’écrire, je l’écris avec une vraie plume, et je raconte une vraie histoire qui va plus loin que ces trucs dont on se fout ».
- Et tu cosignes le livre ?
Billie - Il y avait mon nom sur la couverture, et j’avais fait un post-scriptum du nègre, où je définissais ma manière de faire le nègre, disant que j’avais le droit d’être un nègre à plume, je suis une comédienne de l’écriture, je changerai à chaque fois de style. Mais, ce qui est intéressant, c’est que je me suis quand même planquée, je ne voulais pas qu’on me reconnaisse. J’ai un analyste qui me dit : « tu seras guérie quand tu seras capable de publier en ton nom ». Moi, je trouve une justification à l’existence du livre parce que je le donne à quelqu’un. C’est pas du gâchis, parce que le mec, ou la nana, il est heureux, elle est heureuse, elle a du sens dans sa vie, et ça justifie que je fasse un livre.
- C’est ce que tu disais tout à l’heure : l’écrivain classique serait égoïste, ne penserait qu’à lui, alors que là c’est une démarche de don. C’est ça ?
Billie - Oui. Publier pour des lecteurs, je me dis ça sert à quoi ? Ça n’a pas de sens. Bon, c’est ma névrose, aussi. Donc, le fait de le faire pour quelqu’un, ça justifie d’un coup que je le fasse, et que le livre existe. Et là je me dis peu importe comment ça va marcher derrière. J’ai... pas sauvé quelqu’un, mais j’ai remis quelqu’un sur pied. Ça, voilà...
- D’habitude, le nègre ne co-signe pas le livre, son nom n’apparaît pas sur la couverture. Soit il est totalement absent, soit est crédité à l’intérieur, avec une formule type « avec la collaboration de ». Est-ce que vous signez ce que vous faites ? Est-ce que votre nom apparaît ?
Anne-Laure - Oui, toujours. Et il y a eu deux fois où ça a été oublié. Ça m’a fait comme si je n’avais rien fait.
Stéphane - Deux fois, dans quels cas ? Parce que ce n’est pas des oublis, dans ces cas-là... C’est parce qu’il y a une volonté.
Anne-Laure - O. [animateur télé]. Je ne sais pas pourquoi...
- Tu as fait O. ? Mais tu as aussi fait S. [autre animateur télé] ?
Anne-Laure - Ah non ! S., j’ai travaillé avec lui, ça va pas être possible, tu vois...
Stéphane - Putain, moi je crois que je vais faire un livre avec lui.
Anne-Laure - Non ! T’es malade !
Billie - Tu sais que c’est moi qui devais le faire, au départ ?
Anne-Laure - T’es malade ! T’es malade ! Bon, fais ce que tu veux... J’ai travaillé sur une de ses émissions...
Billie - Il n’a pas voulu de moi.
Stéphane - Je ne sais pas si on va y arriver... Ça fait des années que ça tourne, et là, ça vient de repartir...
Anne-Laure - C’est un malade !
Stéphane - Mais moi, j’ai la peau dure...
Anne-Laure - Il est chiant, il est odieux, il a aucun intérêt, il n’a rien dans le bide...
Billie (à Stéphane) - L’éditeur m’avait fait lire un mail que tu avais écrit quand ils t’avaient proposé de faire son livre. Un mail superbe, où, sur deux pages, tu expliquais quel était le problème.
Stéphane - Sur S. ? Tu as lu ça, toi ?
Billie - Oui, parce que je devais le faire au début. Mais il n’a pas voulu de moi. Dès le premier entretien, j’ai voulu aller au fond, et tu peux pas, c’est pas possible. Il ne veut pas jouer le jeu.
Stéphane - Il n’y a pas de fond.
Billie - Il ne veut pas y aller.
Anne-Laure - Il n’y a pas de fond ! Comment veux-tu qu’il y aille ?
Stéphane - Tu as raison, tu as raison... C’est le vrai problème.
Anne-Laure - Quand les gens sont cons, tu ne peux pas faire un livre.
Billie - Tu mets le fond à leur place, non ?
Anne-Laure - J’ai fait un livre avec un mec tellement con que je le torture, je le machin, je fais tout. Je creuse, tout, « tu te souviens, du papier peint de ta chambre ? » Et rien !
Stéphane - Ça n’existe pas, « rien ».
Billie - C’est une bonne remarque. Il n’y a pas « rien ».
Anne-Laure - Mais si, tu sais, quand les gens sont cons... Quelqu’un qui est bête...
Billie - Mais tu ne mets pas ta propre matière ? Moi, je me retrouve souvent à inventer.
Anne-Laure - Bien sûr, c’est ce que j’ai fait. Le livre fait 110 pages, je l’envoie à l’éditeur : « écoute, je suis désolée, je n’ai écrit que 110 pages, je ne peux rien faire de plus. » On était à quinze jours de la remise de copie ; il me dit : « je m’en fous, le bouquin entier, je l’ai dans quinze jours ». Et là, je te jure, je me foutais devant l’ordi, et je me disais : « dans un quart d’heure, cette page est deux ». Fallait que je fasse le double ! Je ne sais même pas ce que j’ai foutu. Et là, l’auteur s’est obsédé sur la couverture : « la couverture, on ne pourrait pas mettre un ton au-dessus, un ton en-dessous ? »
- C’était qui ?
Anne-Laure - Je te dis pas.
Billie - Je croyais qu’on pouvait dire, et que les noms seraient virés.
- Je couperai tous les noms. Tout sera enlevé.
Anne-Laure - C’était un animateur télé, c’était O., justement.
Stéphane - Mais O., il ne fait pas du cheval ?
Anne-Laure - Non, il ne fait rien !
Stéphane - Parce que je cherche à me mettre dans ta situation... Il faut trouver. Il faut que le mec, il démarre sur quelque chose...
Anne-Laure - À la fin, je lui dis : « ce serait bien que tu relises le livre... » Il est adorable, par contre... « Ce serait bien parce que, je te promets, j’ai déliré, à plein tubes. » Il n’a pas relu !
Stéphane - Il n’a même pas relu son propre livre ?
Anne-Laure - Il m’a dit texto : « je te fais confiance ».
Stéphane - Alors moi, ça n’existe pas, ça. Les gens avec qui je travaille ne sont pas écrivains, mais ce sont les auteurs. Ils travaillent beaucoup le texte : même H. s’est relue.
- (à Anne-Laure) Et c’est justement ce livre dans lequel ton nom n’est pas apparu ?
Anne-Laure - Ouais.
Stéphane - C’est formidable.
Billie - C’est dingue !
Anne-Laure - Attends, c’est un coup de bol ! C’est un tel navet... Mais comme quoi, il y a une justice. On a eu toutes les couv de tous les magazines...
Stéphane - ...de télé...
Anne-Laure - Cinq mille ventes !
Stéphane - Cinq mille ventes ? C’est rien.
Anne-Laure - Non, c’est rien. Cinq mille ventes ! Comme quoi, il y a une justice.
Stéphane - Si maintenant le marché s’organise autrement, c’est parce que dans ces livres-là, il n’y a rien. On fait une promo télévisuelle, on en met plein les têtes de gondoles de supermarché, mais ça ne marche plus du tout !
Anne-Laure - Tu sais, le vrai problème, et ça je te le dis pour S., ça ne sert à rien, si tu as quatre millions d’acheteurs potentiels qui sont les téléspectateurs, et que dedans tu as 95% de gens qui ne lisent pas, il vaut mieux s’adresser à trois cent lecteurs. Parce que tu as trois cent ventes ! Là, O., personne n’en avait rien à foutre.
Stéphane - Tout le monde se fiche de la vie de O. Même la mamie qui le regarde... Il faut être dans le cœur des gens pour devenir vraiment populaire.
Billie - Moi, il n’y a pas longtemps, j’ai fait le bouquin de V. [chanteur star des années 1980].
Anne-Laure - C’est pas mal, ça, non ? Il y a du contenu, non ?
Billie - Et puis ça cartonne, surtout. Mais alors, justement : tu te dis qu’il y a du contenu, mais les entretiens, tu ne peux pas savoir le truc. V., il a été traumatisé par la mort de son père, et, après, il ne se souvient de rien, il était comme en coma. Tu fais dix entretiens avec lui, tu te dis « attends, il a vécu des trucs incroyables », sauf qu’il n’a rien senti, rien vu, rien compris. Impossible de lui faire dire quelque chose. Alors je me suis documenté. Sur ce qu’il a vécu, sur le milieu d’origine de sa famille.
Stéphane - Tu te documentes sur leur vie, en fait ? Parce qu’ils ne sont pas capables de te la dire ? (soupir) Les gens ne sont pas capables de dire leur vie... Ça c’est un grand problème...
Billie - Et je fais trois premiers chapitres où je suis V. C’est-à-dire que c’est froid, c’est lisse, c’est pas intéressant. Et je me dis : « pour une fois, tu es dans ton rôle de nègre. Tu es vraiment V. » J’envoie à mon éditrice. Elle m’appelle, elle me hurle dessus : « c’est quoi cette merde ? » Je réponds : « j’ai fait mon boulot de nègre, je n’ai pas outrepassé, je suis V. » Et là, l’éditrice me dit un truc incroyable, en gueulant : « mais je ne te paie pas pour être V. ! J’en ai rien à foutre de V. ! Putain, s’il n’y a pas de toi, il n’y a pas de livre. » Donc, tu vois, ça arrive souvent... Z. [autre chanteur], c’était pareil...
Anne-Laure - Mais amnésique, ce n’est pas pareil que con. Quand tu es face à quelqu’un qui est débile, c’est-à-dire qui a vraiment 30 de Q.I., tu ne peux rien foutre !
Stéphane - Oui, mais bon, toi tu es une nègre de la masse. Il y a un abattage qui est énorme, tu vois énormément de gens. Tu as fait cinquante livre !
Anne-Laure - Comme nègre, une quarantaine, oui...
Stéphane - Moi, je suis un nègre haute couture. C’est mon image. Une fois. Une femme ou un homme. Et on va prendre le temps qu’il faut, et on va faire un défilé.
- Mais alors, Stéphane, tu refuses beaucoup de choses ?
Stéphane - Non, en fait, si tu veux, je vois Demis Roussos dans un café, dans un palace... Bon, je le vois, je rentre chez moi, et puis on laisse pisser...
Anne-Laure - J’avais fait pareil avec Q. [artiste classique bas de gamme]...
Stéphane - Je ne dis pas non, mais j’attends plutôt Alain Delon et Fanny Ardant.
- Ça veut dire quoi « je ne dis pas non » ?
Stéphane - J’en parle un peu avec l’éditeur : « Demis Roussos, ça ne me paraît pas... » Parce que c’est un boulot de fou, aussi !
Anne-Laure - Oui, il faut être très excité, quand même.
- Il faut avoir du désir en amont ?
Billie - Ouais ! Ou, quand t’en as pas, tu le stimules. Moi, je le stimule.
Anne-Laure - Ah, moi non.
Stéphane - Je n’ai pas voulu être un écrivain maudit, c’est pas pour devenir un nègre maudit ! Le principe du nègre, c’est : on prend l’argent, on écrit le livre, et on recommence. C’est cette espèce de solidité commerciale. C’est suivre le marché.
- Pour revenir à H., Stéphane : comment est-ce que tu as fait pour emmener quelqu’un qui n’est a priori qu’un simple objet de télévision vers quelque chose d’intéressant ?
Stéphane - Alors... Il faut se souvenir que H. était une idole, une idole d’un nouveau monde. On devait louer une baraque à Saint-Tropez, mais les gens ne voulaient pas louer. Quand ils savaient que c’était H., ça faisait un tel bordel, ils ne voulaient pas.
- Comme Strauss-Kahn...
Stéphane - Mais bien sûr ! C’était à la fois l’idole du moment, et la lie de la société... [Ils se remémorent tous les trois ce qui se disait sur H. à l’époque.] C’était un monde inouï... Et moi je me suis dit : « quelle aventure ! Mais quelle aventure ! » Je pense que s’il y un symptôme dans la négritude, c’est celui du voyeur.
Anne-Laure - Oui.
Billie - Je suis assez d’accord.
Stéphane - Je rentre dans une baraque, et je vais tout savoir.
Anne-Laure - Moi, plutôt que voyeur, je dirais enquêteur, flic. J’aurais pu être enquêteur, tu vois, à la brigade criminelle...
Stéphane - Il y a un voyeurisme, mais sur une situation d’exception. H., j’avais suivi ce qu’elle faisait à la télévision... Savoir ! Savoir ce qu’il y a derrière... Derrière l’image...
Billie - Y compris s’il n’y a rien...
Stéphane - Être en présence de... oui, d’une forme de mythologie contemporaine. Parce que les gens sur lesquels on nous envoie sont toujours des monuments nationaux, quand même...
Billie - Sauf qu’en faisant le livre, tu contribues à cette mythologie...
Stéphane - Oui. Donc je raconte, avec H. On déboule à Saint-Tropez : la situation est apocalyptique. H. a quatorze portables, quatorze gardes du corps, quatorze relais productifs. Donc, elle s’installe dans cette maison. Elle m’a choisi. Parce que je n’étais pas le seul en lice...
- Il y a eu entretien d’embauche ?
Stéphane - Oui. Il y a eu un casting de nègres. Dans le bar d’un grand hôtel, elle en a vu passer douze dans la matinée...
- Il fallait bien se vendre, donc.
Stéphane - Oui. Moi je lui ai parlé de deux choses. Son chien, et sa mère. Et j’ai gagné. Bref, elle est dans cette baraque. L’éditeur a signé un chèque énorme. Il a publié des très grands noms de la littérature du XXè siècle, et, là, il m’appelle tous les jours : « alors, où on en est ? » Je vois des gens énormes se placer dans des positions insensées. Parce que c’est une montagne de blé ! Parce que c’est l’hystérie du moment ! Parce qu’on a donné un million de francs ! Et on ne sait pas du tout ce que ça va donner... Et là, pendant huit jours, je n’entends pas la voix de H. Je ne sais pas où elle est. C’est quasi-impossible d’arriver à la villa, tellement c’est embouteillé. Ensuite, le garde du corps dit : « elle n’est pas bien » « Ah bon, elle sera pas bien jusqu’à quelle heure ? » « Jusqu’à minuit. » Alors, à minuit, on appelle. « Ah là, elle dort. » « Ah bon, mais jusqu’à quelle heure ? » « Bah jusqu’à quatre heures ». Alors, à quatre heures, on rappelle...
- Quatre heures du matin ?
Stéphane - Oui, du matin. « Elle est où, H. ? » « Elle est partie en boîte de nuit, on ne sait pas où elle est. » Et l’éditeur, tous ces gens de culture : « elle est où ? » Un soir, je dis à l’éditeur : « écoutez, j’ai une doc énorme ; on a des nouvelles de H. dans les journaux tous les jours, on sait qu’elle a caressé un dauphin, on sait qu’elle a vu des bébés-tigres dans un zoo ; allez vous coucher, je vais me démerder ». Et je fais trente pages, je me dis « je suis H., je vais caresser la peau d’un dauphin, ça m’a bougé le cœur ». Et l’éditeur me dit : « écoute, c’est formidable. Donc, à la limite, on aurait pu ne pas voir H. du tout... » Mais j’essayais d’être vrai ! Et j’allais continuer comme ça, mais, finalement, H. est arrivée. Je demande à l’éditeur : « qu’est-ce qu’on fait de ces trente pages ? On lui fait lire ? Parce que si on lui fait lire, on lui dit, en gros, qu’on peut écrire son livre sans elle. » Pour nier quelqu’un, on ne peut pas faire pire... Finalement, je lui ai fait lire à la fin, ça a été compliqué. Et, après, on est rentré dans une analyse. Parce que nègre, en fait, c’est faire une analyse.
Anne-Laure - Complètement !
Billie - Justement, moi, à la fin de chaque livre, j’ai tellement donné, il y a eu tellement transfert, que je suis morte. Je suis à ramasser à la petite cuillère. Parce que j’ai pris toute la merde, j’ai épongé tout.
Stéphane - Ah oui, on éponge...
- Mais quand tu écris le livre, tu ne le ressors pas ? Tu ne le recraches pas ?
Billie - Je le ressors, mais je me suis mise dans des états, quand même, avec des conséquences... Et j’ai deux semaines de dépression aigüe. Surtout que j’ai souvent des histoires tragiques.
Stéphane - Moi, c’est l’inverse. Ce que je trouve formidable, quand on est nègre, c’est que tout est à blanc. Cette douleur-là, c’est pas la sienne. Comme un psy, comme un gardien de prison, comme tous les métiers d’accompagnement douloureux, comme un acteur, aussi, quand tu rentres chez toi, c’est fini, c’est pas ton histoire. Et, moi, cette espèce de confort de cette écriture-là, ça me va très bien. Si quelqu’un me raconte la mort de sa mère, ce n’est pas la mienne, donc je peux partager ça, mais quand je referme, le travail s’arrête. Il n’y a pas d’obsession, en tant que nègre.
Anne-Laure - Moi, j’éponge complètement. Et c’est pour ça que je ne fais plus de bouquins très durs. Quand je dis très durs, c’est pas... Tu vois, H., sa vie est dure, mais elle a changé de monde... Il n’y a pas que la misère. Moi, j’ai fait des livres où ce n’est que la misère. C’était une série en fait. C’est pour ça que j’en ai fait beaucoup, parce qu’il y a eu une année où j’en ai fait six. C’était une collection, donc c’était à flux tendu. J’ai fait l’inceste, les SDF, les putes... Ce n’était supportable que parce que je picolais. Sinon, ce n’était pas possible ! C’était humainement pas tenable. Parce que c’était des trucs hyper denses, où les gens en gros vivaient chez moi... C’était infernal. Moi, ça je ne peux plus. C’était des gens qui étaient dans une extrême misère, et qui y sont encore. C’est comme être travailleur social. Je ne vais pas me faire plaindre au-delà de la réalité, parce que le travailleur social, lui, il fait ça toute l’année. Mais moi, je ne peux plus.
Stéphane - C’est bizarre, parce que, moi, c’est ma jouissance. La douleur de quelqu’un, elle fait ma jouissance, en tant que nègre.
Anne-Laure - Moi aussi. Je n’ai pas dit que je ne pouvais pas faire psy. Je peux éponger la douleur. Je ne peux plus éponger la misère, ce n’est pas pareil.
- Stéphane, pourquoi tu parles de jouissance ?
Stéphane - Parce que, en tant que nègre, il faut transformer la souffrance de quelqu’un, sa souffrance prisonnière et personnelle, souvent... Parce que les gens s’accomplissent dans le chagrin. Quand ils racontent leur vie, souvent, ils vont dans le chagrin. On raconte la gloire, on raconte pourquoi ils sont là, et puis au bout d’un moment, quand on veut du fond, le fond ça les amène à des chagrins. C’est comme ça... tout le monde est pareil. Je me souviens, pour mes premiers travaux : la personne vous parle, la personne s’en va, vous restez avec ce qu’elle a dit. Et puis il y a le moment où elle revient pour voir ce que vous avez écrit de sa parole. Et là je lui lis... Ça se passe toujours comme ça.
- À l’oral ?
Stéphane - Oui. Jamais je ne lui dis : « tenez, vous lisez ça ». Je ne sais pas pourquoi, j’ai besoin de lire. Éventuellement, c’est l’autre qui lit, mais il y a toujours une lecture à voix haute. Toujours. Mais on a le temps, hein. Moi, je ne travaille pas sur cinquante livres. J’aurais pu, à la limite. Mais je travaille toujours sur un livre par an ; ou deux. Donc, ils reviennent, et moi j’ai essayé de transformer, finalement, cette espèce de masse compacte, de chagrin, de non-dits, de difficulté à dire - mais ils disent quand même. Je suis très frappé : on a parlé de l’infirmité à se raconter, mais quand on les pousse, quand ils se trouvent, les gens disent des choses extrêmement belles. Très souvent ! Parfois ils te disent quelque chose - je ne sais plus, j’ai trente mille exemples en tête - et tu te dis « putain, quelle beauté ce truc ! »
Anne-Laure - Oui, quand des gens te disent une phrase et tu te dis « putain, je ne l’aurais pas écrite ! »
Stéphane - Voilà ! Et cette chose pilote le texte. H., je me souviens, disait tout le temps : « j’étais pas là ». « J’étais pas là »... Il y a des gimmicks, on voit des choses apparaître. Donc, ils reviennent pour qu’on lise le livre. Et, à ce moment-là, ça s’inverse parce que c’est moi qui flippe, parce que je me dis comment elle va le prendre... Un des grands plaisirs de cette aventure, c’est qu’on est deux, alors que quand on est un écrivain, on est vraiment tout seul...
Billie - Ça, c’est très juste.
Stéphane - ...alors que nègre, c’est quand même de l’écriture, c’est quand même faire du texte, même si on ne va pas déranger la littérature pour ça... Mais il y a quelqu’un qui réagit, comme un acteur, comme au cinéma : on n’est pas tout seuls. Et une des grandes beautés de ce métier, c’est quand quelqu’un qui est muré, en face de vous, s’entend à travers des pages, se trouve à travers des pages...
Billie - Se reconnaît !
Stéphane - ...se reconstruit à travers des pages. Et craque ! Craque ! Moi, j’ai des gens en larmes dans mon bureau, tous, tous, tous. Ils ne sont pas en larmes parce qu’ils sont détruits, ils sont en larmes parce qu’il y a une forme de renaissance, par le livre. Ils intègrent enfin une image d’eux-mêmes à laquelle ils n’avaient jamais réfléchie, et ils l’aiment !
Billie - Attends, tu es en train de leur dire qu’il y a un sens, un ordre, une construction...
Stéphane - Absolument ! On voit apparaître le sens de la vie des gens ! C’est un truc de fou.
Billie - La vie, c’est arbitraire, ça n’a pas de sens.
Stéphane - Le livre donne un sens à la vie des gens. C’est incroyable d’ailleurs comme les gens portent très très haut le livre. La mythologie du livre, en France, elle est énorme. Raconter sa vie, dans un livre : je n’ai jamais eu quelqu’un qui me dise : « tu t’en démerdes, ça m’intéresse pas ». Moi, ça ne m’est jamais arrivé.
- Même les hommes politiques ? Vous faites des livres d’hommes politiques ?
Billie - Moi, oui.
Stéphane - Non, je n’en ai pas fait.
Anne-Laure - Les politiques, pour revenir à ce que disait Stéphane sur le plaisir, sur le côté très psychanalytique...
Stéphane - Oui, une émotion...
Anne-Laure - Il n’y en a pas, avec les politiques. Le mec, il se vend.
Billie - Et puis tu es dans la pensée, pas dans la vie.
Stéphane - Moi, la seule personne où je n’ai pas obtenu quelque chose, où il ne s’est rien passé, mais on repassera peut-être les plats, c’est S. [animateur télé]. Et le livre ne s’est pas fait. Mais c’est le seul avec lequel il ne s’est rien passé. On s’est vus beaucoup. Et moi, j’attendais. Qu’il se passe quelque chose. Et il ne se passait jamais rien... Alors, il y a quelque chose qui arrive souvent. Très vite, les gens racontent un truc, et disent : « mais ça, ça ne sera pas dans le livre ». Dès qu’ils ont un truc réel à dire...
Billie - Et vous faites quoi, dans ces cas-là ? Parce que moi, je leur dis : « d’accord, mais ne t’inquiète pas, parce que tu sais, les mots... Tu verras, on pourra le placer, mais dit d’une certaine manière. »
Stéphane - « On coupera après, lâche-toi... »
Anne-Laure - Exactement ! Moi aussi.
Stéphane - « Allez-y... Vous avez le cut. Vous êtes le pilote. Moi, je n’existe pas. On va faire la traversée... Surtout, ne vous privez de rien. » Quand tu leur dis ça, ils y vont. Ils lâchent les grands points.
Billie - Ça les libère.
Stéphane - Eux sont persuadés que ça ne sera pas dans le texte. Et moi, je suis persuadé que ça sera les grands reliefs du texte. Le texte s’armature toujours sur ce que les gens te racontent en disant : « ça, je ne le dirai pas ».
Billie - Et, à la fin, ils sont contents que tu l’aies dit, t’as vu ?
Stéphane - Voilà. C’est ça qui fait leur bonheur. C’est ça qui fait leur liberté.
Billie - C’est même ce qu’ils préfèrent dans le bouquin.
Stéphane - Toujours. Toujours. Sauf les cas où c’est clivé. Moi, je n’en ai pas eu beaucoup, mais j’ai eu S. Voilà. S. te raconte une partie de chasse où il éventre un sanglier, et il te dit : « ça sera pas dans le texte, parce que les petits gamins qui m’aiment ne veulent pas que je sois un chasseur de sangliers ». Mais c’est un chasseur !
- C’est-à-dire qu’il contrôle parfaitement son image, il refuse de s’abandonner ?
Stéphane - Avec B.[autre animateur télé], je lutte constamment contre ce que j’appelle le contrôle et le pilotage automatique, c’est-à-dire que, c’est vrai, il y a des gens qui peuvent parler trois heures, mais en fait ils ne parlent pas. C’est pas de la parole, c’est une occupation. D’eux, du temps, de l’espace. Donc, tu attends. Moi, j’attends. Je parle très peu, quand je vois les gens, en entretiens. J’attends, j’attends - et ils sentent l’attente, aussi. Au bout d’un moment, ils basculent doucement. Et puis il y a un truc qui les prend. Et, hop, ça s’entend. Hop, hop, hop.
Anne-Laure - Moi, je n’enregistre pas, je prends des notes. Et je fais de l’interview en deux couches. C’est-à-dire que je laisse couler, la ou les premières séances. Et à la séance d’après, je reviens : « tu vois, tu as dit cette phrase, et je voudrais que tu m’expliques ». J’ai deux couches. Au début, je ne veux pas les interrompre.
Billie - C’est marrant que tu prennes des notes. Pour moi, c’est essentiel, le dictaphone.
Anne-Laure - Moi non.
Billie - J’ai besoin de leur voix... P. [compagne d’un chanteur à scandale], quand je l’écrivais, je mettais les cassettes en fond sonore. Les flots de P., ses silences, j’ai besoin de ça. C’est pour ça que je suis obligée de fonctionner au dictaphone.
Anne-Laure - Oui, mais pas pour le contenu. Moi, j’ai une cassette témoin, souvent de la première séance, et je l’écoute juste pour la musique.
Stéphane - Mais sinon, tu ne travailles pas à la voix ?
Anne-Laure - Jamais. Jamais. J’écris, c’est monstrueux, tu vois le niveau de l’encre qui descend dans le stylo. Et je dis toujours : un livre, c’est un gros bloc Clairefontaine.
Billie - Il y a des nègres qui enregistrent, et qui font dérusher par des mecs de la maison d’édition. Je ne peux pas, moi.
Stéphane - Ah oui, j’ai eu un assistant qui dérushait mes cassettes, mais j’ai arrêté. Il faut que je dérushe moi-même. C’est quand tu dérushes que tu fais le livre.
Billie - Exactement. Alors, ça prend des plombes. Mais c’est nécessaire. Tu ne peux rien sous-traiter.
Stéphane - C’est une des grandes contraintes du métier, mais c’est le cœur centrifuge du métier : tu es quand même chez toi, et tu vas réécouter dix fois ce que dit quelqu’un. Et, au bout d’un moment, tu l’entends buter, tu l’entends revenir, tu vois le mot qui revient tout le temps. Il y a quand même une introspection incroyable, de décrypter le langage de quelqu’un. Et je ne suis pas à l’aise quand je n’ai pas décrypté mes cassettes, même si ça me fait chier...
- On n’a pas encore parlé d’argent. Vous touchez combien pour écrire ces livres ?
Stéphane - Moi, je prends un tiers des droits d’auteur.
Anne-Laure - Moi, ça dépend de la notoriété.
Billie - Moi, je suis complètement débile, je ne négocie pas, et la plupart du temps on me file 2%.
- 2% du prix de vente, donc ça veut dire 20-25% des droits d’auteur.
Billie - Là je ne parle pas des avances. Les avances, je suis quasiment toujours payée la même chose, ce qui n’est pas énorme, hein. 10.000 euros. Globalement, ils me filent 10.000 euros.
Anne-Laure - Moi aussi, 10.000 euros.
Stéphane - 10.000 euros, en deux fois ?
Billie - Non, en trois fois. Signature du contrat, remise du manuscrit, et publication.
Anne-Laure - Moi, je ne lis que les chiffres, dans les contrats. Parce que c’est trop long...
Stéphane - Moi aussi : les chiffres, c’est l’argent et le délai.
Anne-Laure - Moi, sur mes deux derniers, j’ai eu sur chacun 10.000, et le pourcentage, c’est entre 3 et 5% [soit entre 30 et 50% de ce que touche l’auteur qui signe].
Stéphane - C’est du même ordre pour moi, les pourcentages.
- Mais tu touches aussi le même pourcentage sur l’avance ?
Stéphane - Ça dépend. Un à-valoir, pour moi c’est au moins 30.000 euros. Et avec B. [animateur télé très vendeur], c’est institutionnalisé que je touche une très grosse avance, donc un tiers du total. Avec quelqu’un d’autre où les avances sont plus faibles, je fais moitié-moitié.
- Quand on écrit pour quelqu’un de très très riche, par exemple B., pourquoi est-ce qu’il n’abandonne pas à son nègre tous les droits d’auteurs, qui restent quand même faibles par rapport à ce qu’il gagne par ailleurs ?
Stéphane - Je ne l’ai pas vu comme ça. Si ce n’était pas B., on n’en vendrait pas. Ce patrimoine de notoriété lui appartient... B., il écrirait le bottin, on en vendrait 80.000... Bon, il se trouve que c’est mieux que le bottin...
Billie - C’est une vraie association. Il faut le nom du mec, et la qualité du texte.
- Si le bouquin n’est pas bon, même si le mec est connu, il ne se vendra pas ?
Anne-Laure - Non, il ne se vendra pas.
Stéphane - L’édition des années 1970, qui était vraiment basée sur les supermarchés, où on fourgue de la merde à des abrutis, ça ne marche plus.
- Et à propos de la frustration que génère votre situation...
Billie - Je n’en ai pas, moi.
Anne-Laure - Je suis jouasse, moi.
Stéphane - Non, non... Moi, j’ai tout fait pour ne pas écrire, mais ça a recommencé. Je vais ressortir un roman l’année prochaine.
- Donc ça exclut de travailler pour d’autres ?
Stéphane - C’est-à-dire que j’étais parti pour être écrivain, j’ai toujours voulu faire ça, et puis nègre a suspendu tout, parce que je ne voulais pas être dans la moulinette. Et là, j’ai repris la moulinette... Et ça a bougé mon style. Il y a quelqu’un qui a dit une phrase qui m’avait troublé, c’était un nègre, à propos des nègres : à force d’éclaircir la voix de l’autre, on perd la sienne. C’est-à-dire : on n’a plus de voix. Moi, je n’ai jamais pensé ça. Le fait de s’occuper de quelqu’un ne gomme pas votre identité, au contraire. À mon avis. J’avais besoin d’être nourri, de vivre des aventures, d’avoir de la viande. Donc, je n’ai jamais pensé que nègre était fantomatique, ou un effacement. Je me suis remis à écrire pour moi, et, en effet, quand je fais une phrase qui est trop longue, j’en enlève un tiers. Des choses comme ça : quand il y a quatorze adjectifs, j’en mets deux. C’est comme un grand peigne : la langue devient un grand peigne, et ce grand peigne très mécanique de la clarté, de la ligne claire du récit, je l’ai récupérée. Et quand je me relisais, je me disais : « merde, je ne vais pas faire une bibliothèque verte, quand même ! » Parce que je suis un baroque, moi... Et là-dessus, j’ai travaillé, et ce que j’écris est peut-être meilleur que quand j’étais jeune, parce qu’il faut garder sa voix, et en même temps ça a été des gammes extraordinaires. Un nègre, c’est quelqu’un qui fait des gammes.
Billie - Exactement !
Stéphane - Ça te donne un muscle, au niveau du récit, au niveau de la composition, tu as un muscle... Pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu enchaînes sur ça...
Anne-Laure - Tu sais faire un livre !
Billie - Est-ce que vous cherchez un style à chaque fois ? Moi, je crois que j’essaie de trouver un style à chaque fois, une respiration, un rythme, et un style qui soit vraiment celui pour qui je le fais. Et je dis que je suis une comédienne de l’écriture, et j’aime bien dire ça. Au point, que parfois, mon éditrice, cette garce, elle me met dans des systèmes Actor’s studio, c’est-à-dire que pour V., elle me dit : « Dis donc, le passage sur son père, là, qui est à l’hôpital, qui a le cancer, tout ça, toi tu t’es occupée de ta pote qui avait un cancer, pendant un an... T’y vas ! » « T’es vraiment une salope... » Et j’y vais, et je souffre... « Le moment où elle se fait taper, femme battue, t’y vas ! » Donc je change de style à chaque fois, et, au bout d’un moment, à force de changer de style, je ne sais plus quel est le mien. Elle est où ma forme ?
Anne-Laure - Moi, je suis comme Stéphane. Je suis aussi extrêmement baroque quand j’écris pour moi, c’est-à-dire les adjectifs, les subordonnées, les trucs, il y a même des moments où je me relis : « putain, respire ! Fous un point ! », tellement j’en peux plus. Je viens de finir un livre pour moi, un essai, et l’éditrice me dit : « cette phrase est peut-être trop longue », et là j’hurle ! Autant je suis d’une souplesse dans mon boulot, tu me fais faire ce que tu veux, mais là c’est ma liberté, pour une fois que j’écris ce que je veux, je me fous que les gens détestent, que les gens le lisent pas, que ça se vende pas. Je ne veux plus qu’on y touche.
Stéphane - Moi, mes derniers livres étaient quand même pas mal investis littérairement : j’ai travaillé avec des gens qui entrent dans la pièce en posant du papier sur la table. Les gens qui écrivent, même si c’est mauvais, font des livres à la qualité littéraire beaucoup plus grande. Écrire, c’est déjà tellement une sélection, c’est déjà tellement tisser des sensations, c’est tellement plus rare que ce qui vient à l’oral, que toi quand tu récupères ça tu montes le texte en valeur littéraire. C’est comme ça que le livre de L. [chanteur à la longue carrière] se retrouve étudié au baccalauréat, quand même. L. ! Parce qu’il écrit. Il a écrit des chansons, donc il sait ce que c’est qu’une phrase... B. [animateur télé] ne sait pas ce que c’est qu’une allitération, L. il bosse déjà sur les allitérations. Il préfère voir écrit... une folie floue, à... une folie belle.
Billie - Oui, il a quand même un sens...
Stéphane - Donc, après, quand tu travailles là-dessus, ça monte, ça monte... Après, la beauté, chez le nègre, elle vient de la clarté de la vérité, très souvent. C’est-à-dire que ce n’est pas dans la description, c’est plutôt une sorte de vérité qui s’installe, un langage très clair, et ça forme une espèce d’émotion. Et j’ai toujours eu une trouille, moi, même quand on travaille le texte de manière singulière, c’est qu’au fond ces livres que je fais en tant que nègre ne forment qu’une seule ligne, à travers des auteurs différents. Mais c’est toujours une même voix...
Billie - C’est ta voix, en fait.
Stéphane - C’est une double voix à chaque fois, mais il y a une sorte de pass universel, une sorte de récit de la vérité, et ce pass universel vaut pour tous les livres.
Billie - C’est très juste.
Stéphane - Et moi, c’est ça qui m’angoissait. Je sais comment on peut faire une bonne page pour la terre entière. Une bonne page, à la fois ciselée et claire, et tout le monde trouve ça bien. C’est pas dégueulasse, c’est plutôt de bonne facture. Ça serait le McDo universel de l’écriture.
- Mieux que le McDo... Une espèce de world food de bonne qualité...
Stéphane - Voilà. Et ça, ça me trouble beaucoup. La phrase parfaite, c’est-à-dire que mon copain ultra littéraire, ma mère très âgée, vous, tout le monde dira : elle est bien, celle-là.
Anne-Laure - Je compare ça au menuisier qui fabrique une table. Tu sais faire une table qui tient debout, avec les quatre pieds de la même hauteur. Après, tu peux lui foutre des tiroirs, la faire en acajou, en plastique, en ce que tu veux. Mais tu sais fabriquer une table. Moi, il n’y a pas un bouquin où tu te fais chier, honnêtement. Après, tu peux ne rien en avoir à foutre...
Stéphane - Quand je parle d’une langue qui serait un pass universel, et que Anne-Laure parle de la table, on parle de la même chose, c’est-à-dire un artisanat de la narration.
Billie - Exactement !
Stéphane - Adapter un outil à la main de l’auteur.
- En sachant qu’on ne sera jamais un génie, c’est ça ?
Stéphane - Bah...
Billie - Il y a une forme de génie, à faire ça...
- Le génie de l’artisan, on le connaît. Mais je parle du génie de l’artiste.
Stéphane - Je ne dérange jamais la littérature pour un bouquin que je fais en tant que nègre. Même s’il est bien.
Billie - Il est concret, le génie de l’artisan, beaucoup plus concret que le génie de l’artiste.
Stéphane - Cette année, un des premiers livres que j’ai lu à la rentrée, c’est celui de Jenni, sur l’Art français de la guerre, qui a eu le Goncourt. Bon. C’est formidablement... c’est un génie... Maintenant, si je passais la main là-dedans, je rendrais le livre meilleur. Et, justement, je me suis posé la question : quand je voyais des grands déséquilibres dans le livre, je me disais : « mais que doit faire l’éditeur ? » Est-ce que d’un petit coup d’épaule tu remets d’équerre, ou ce n’est pas une question d’équerre, voilà... Il y a des moments où la langue est l’auteur, elle échappe à la question de l’équerre, et là, on est dans la littérature.
- Ça vous arrive de rester proches des gens pour qui vous avez écrit ?
Anne-Laure - Pas trop.
Billie - Pas trop. Parfois, dans les mois qui suivent, un peu... V., par exemple, il était hyper reconnaissant. Tout le monde lui disait : « tu n’as pas une autobiographie, tu as un livre ». Et il était hyper reconnaissant, il m’a invité deux fois, il m’a traité en princesse, il me faisait des cadeaux. Ils me font souvent ça, les people, ils m’invitent à la fin. J’ai le sentiment que c’est une façon de payer leur dû, et de se sentir libre vis-à-vis de moi. V., on ne se revoit pas ; si on se croise dans deux mois, on sera contents de se parler, mais... Il faut tuer le nègre, même si le nègre est apparent. Pour qu’ils deviennent adultes dans leur truc...
Stéphane - Moi, c’est un peu particulier. Je ne fais pas qu’un livre pour un auteur, en général, j’en fais deux, ou trois. Là, je prépare le troisième de L...
Billie - J’ai une question. Est-ce que vous couchez avec les clients ? Moi, je pense qu’on n’est pas dans ce rapport-là.
Anne-Laure - Ah oui, c’est impossible.
Billie - J’ai travaillé avec des mecs qui étaient des queutards, mais ils n’étaient pas dans ce rapport-là.
Anne-Laure - Ah, pas du tout.
Stéphane - On couche rarement avec son psychanalyste.
Billie - Oui, tu ne baises pas avec ton psy. Ils oublient ton physique.
Anne-Laure - Ça arrive, d’ailleurs, que des gens demandent, à propos d’un mec pour qui j’écris : « alors, vous baisez ? » Et ça te choque, comme si tu baisais avec ton père. C’est ignoble.
Billie - Exactement, c’est transgressif.
- Mais est-ce que vous êtes forcés d’aimer la personne pour qui vous bossez ?
Anne-Laure - Ah oui.
Billie - Oui, c’est obligé. Je ne peux pas, autrement. Tu es en empathie. Et si tu l’es pas au début, tu le deviens.
Stéphane - Je pense que c’est plus que de l’empathie. Une fois, j’ai failli écrire le livre d’un assassin, et je regrette de ne pas l’avoir fait. Oui, j’adorerais faire le livre d’Adolf Hitler...
Billie - Moi j’aurais adoré faire le bouquin de Mao. Mais il est mort...
Anne-Laure - Ah non, je ne peux pas, ça. Tu es obligé de comprendre l’autre, et moi je refuse de me faire violence. Pas envie.
Stéphane - Alors empathie, dans un autre sens. Moi, je suis en empathie à partir du moment où la vérité s’établit.
Anne-Laure - Hitler repenti, alors ?
Stéphane - Non, pas repenti. Mais : la vérité. La connaissance. La connaissance d’une vie et d’une personne, ça crée chez moi une empathie. Ce n’est pas son caractère qui génère de l’empathie.
Anne-Laure - Moi, ça ne me suffit pas.
- C’est comme un biographe : quelqu’un qui fait la biographie d’Hitler, on ne va pas le soupçonner de...
Stéphane - Comment cette vie fonctionne ? Comment cet homme fonctionne ?
Anne-Laure - Moi je ne veux pas faire du bien à quelqu’un qui me répugne. Je ne veux pas qu’il vienne chez moi. Je ne veux pas qu’il se soit assis sur mon canapé.
Billie - Moi, je considère qu’il n’y a pas de méchants, que des fous. Hitler, tu vois, c’est un individu, qui a des failles, des douleurs. Et c’est horrible parce que nègre, ça t’aide à comprendre de mieux en mieux les gens, et à être de plus en plus tolérant. J’ai une tolérance qui devient insupportable. J’en suis à un point où j’excuse tout le monde ! C’est insupportable à vivre. Tu as une tolérance qui te fait toujours voir la part humaine, et la part à laquelle tu peux t’attacher, parce que tout être humain est intéressant. Même le mec le plus immonde...
Stéphane - Quand j’étais jeune journaliste, j’avais interviewé Nathalie Sarraute. Elle parlait du racisme : « franchement, si vous imaginez dans 150 ans, tous les gens qui sont là seront des squelettes, et moi je ne saurai pas distinguer dans un squelette qui était un noir, qui était un blanc. » Hé bien, dans la négritude, il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette vérité, c’est le moment où l’on voit se gommer beaucoup de choses qui s’expliquent, et on arrive à une espèce d’os blanc qui est... l’appartenance à l’humanité. Et on le voit chez un animateur télé répugnant, chez une pute martyrisée... Cette blancheur de l’humanité, si vous faites bien votre boulot, c’est ce à quoi le cutter arrive, et c’est ce qui fait l’empathie. C’est pour ça que je pense que c’est un boulot d’humanité. C’est pas que je suis compassionnel. Quand quelqu’un est dans la merde, j’attends que ça se passe, je ne suis pas du tout un bon samaritain. Mais, ce que je sais, c’est qu’on fait le voyage vers l’os. On fait le voyage vers l’humanité.