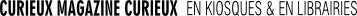


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


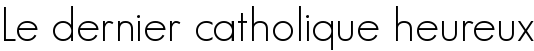
VANITÉ : A. - [À propos d’une chose] 1. Caractère de ce qui est vain, de ce dont la réalité ou la valeur est illusoire. 2. Caractère de ce qui est inutile, de ce qui ne peut rester que sans effet. 3. Gén. au plur. Choses vaines et futiles ; en partic., propos vains. 4. BEAUX-ARTS. Représentation picturale évoquant la précarité de la vie et l’inanité des occupations humaines. B. - [À propos d’une pers.] Caractère d’une personne satisfaite d’elle-même et étalant complaisamment son plaisir de paraître.
30 janvier, 19 heures. Dans la salle du Procope qu’on aperçoit depuis la rue de l’Ancienne-Comédie, quelques couples ont commencé de dîner, mais globalement, c’est vide. Les voituriers attendent leurs voitures, le tapis rouge est taché, l’air est glacial. Le restaurant se vante d’être le plus ancien de Paris ; il attire une clientèle de touristes vaguement fortunés : une sorte de Fouquet’s de la rive gauche, un peu plus chic, un peu moins célèbre. J’entre. « Le prix des Lumières ? - C’est ici, Monsieur. » À gauche de l’entrée, une salle de restaurant ; à droite, une autre salle de restaurant. En face, un escalier. Personne, si ce n’est le cerbère qui possède la Liste. Je m’approche. « Monsieur... ? - Zéo. Le Tigre. » Le doigt glisse sur le long de la liste. « Avec un Z. À la fin. » Le doigt parvient en bas de la page : rien. Pas de Z. « Ah. Bianchi, peut-être ? Lætitia Bianchi. Le Tigre. » Le doigt remonte. « Non... je ne vous ai pas... Comment avez-vous dit ? » Et Cerbère ajoute mon nom sur un post-it. Tout va bien. C’est à l’étage que « ça » se passe : le prix des Lumières sera remis ce soir, pour la première fois, à l’auteur d’un « essai politique, philosophique ou sociétal ». Sociétal : le mot, dont il faudrait faire l’histoire, a avantageusement remplacé le bon vieux « social » dans le vocabulaire politico-médiatique. Avant, il y avait la « question sociale », le problème des riches et des pauvres, la lutte des classes, quoi. Maintenant, il y a les « questions sociétales » : la parité, le mariage gay, l’identité nationale, l’immigration, etc. Les cinq finalistes de ce concours d’illuminations post-modernes sont donc : L’Influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, de Ruwen Ogier ; Éloge du risque, de Anne Dufourmantelle ; Nous, animaux et humains, de Tristan Garcia ; Métamorphoses de l’amour, de Nicolas Grimaldi ; et La Société des égaux, de Pierre Rosanvallon. En attendant que la fête commence, je visite. Tout est soyeux, tout est pastel, tout est moquette. Des petits escaliers, des pièces en enfilade, pas si grandes. Le papier peint n’est pas de première fraîcheur, et les citations des grands hommes ayant fréquenté les lieux ornent les moulures - Danton, Rousseau, Diderot, Desmoulins. La cérémonie est prévue dans le salon « Benjamin Franklin ». Une petite estrade, avec pupitre, attend son heure. Le chef est là, avec son uniforme de chef, qui inspecte ses sous-chefs qui surveillent si les commis ont les doigts propres, ou presque. Les serveurs mettent en place les dernières fourchettes et les dernières assiettes. Les attachées de presse et responsables de la communication du groupe Frères Blanc, qui possède le Procope, sont en place. Aux toilettes, à la place du classique « Dames » et « Messieurs », les portes sont marquées « Citoyennes » et « Citoyens ». L’Esprit est partout. Des photos-souvenirs qui ornent les murs. Elles témoignent du passage en l’auguste lieu de Pascal Sevran, Anna Gavalda et Claude Sarraute. Il est 19 heures 25 et l’étage commence à se peupler. Je me plante dans le salon du milieu, devant une table où sont disposés de gros réchauds qui accueilleront, tout à l’heure, des plats en sauce. Une femme vient me parler : elle est mince, élégante, blonde, et me demande « si je connais l’heureux élu ? » - elle veut parler du lauréat, car pour bousculer les usages bourgeois, le prix Procope des Lumières a décidé de donner un coup de boule dans les convenances, en offrant au peuple de France le secret des délibérations de son jury. Cette première historique est diffusée sur Radio France, grâce à Olivier Poivre d’Arvor, frère de l’autre et ci-devant président de France Culture, et membre dudit jury. Donc, si l’on est intéressé par le prix, on peut connaître à l’avance le nom de son vainqueur. Nous convenons que c’est un principe un peu stupide. Une femme qui s’est jointe à nous n’est pas d’accord : elle avait eu cette idée géniale quand elle avait « créé le prix littéraire de France Télévision », mais « Elkabbach avait refusé ». La mince et élégante femme blonde m’explique qu’elle est philosophe, et qu’elle a déjà « failli » recevoir un prix, mais que tout cela est arrangé à l’avance entre maisons d’éditions. Les salles se remplissent vraiment de gens bien mis, mais pas trop. Il y a même des jeans. À 19 heures 43, comme tout le monde, je me fais servir un verre de champagne, le premier d’une longue lignée. C’est déjà la queue : un vieux monsieur me bouscule, il en prend deux, un pour lui et un pour sa femme. Je me promène. Je fais des statistiques : je compte environ autant d’hommes que de femmes, deux Noirs (ils seront rejoints par un troisième), un nœud papillon, deux bonnets, dont l’un sur la tête de Jean-François Derec, seul « people » que je parviendrai à identifier. Un groupe d’hommes parlent voitures (« Alors moi et ma petite Mercedes au milieu de toutes ces bagnoles... »), on se reconnaît, mais on n’est pas sûr (« Il lui ressemble mais il maigri... Il a perdu vingt-cinq kilos ? »). Il y a une femme, noire, très belle, que tous les hommes regardent - il faut dire qu’elle a une robe-fourreau rouge - mais elle est venue au bras d’un homme à l’air important. Il fait très chaud et je me demande comment fait la femme à la toque en fourrure pour la garder sur la tête. À 19 heures 50, François de Closets (journaliste-vérité-anti-langue-de-bois), membre du jury, apparaît sur les radars des invités. « Ils arrivent » : les membres du jury, leur délibération terminée, débarquent de la Maison de la Radio. Bientôt se pointent Caroline Fourest (féministe-laïciste-Le Monde-Charlie Hebdo) et Aude Lancelin (Gwyneth Paltrow-culture-Marianne). C’est l’effervescence : c’est à qui se saluera le premier, « Ah ! Malek [Chebel, islam-modernité], quel plaisir ! Comment vas-tu ! ». Le peuple des Lumières migre lentement vers le salon Franklin. Comme pour un concert, je me trouve une place près de la scène, à gauche. Bonne idée. Cinq minutes plus tard, un vieux type défraîchi me bouscule, suivi par son aréopage. C’est Son Excellence Jacques Attali, le Grand Spécialiste, président du jury. Il porte des vêtements trop grands. Son pantalon est si long et si large que ses chaussures en dépassent à peine ; pour le dire vite, papy se marche sur le falzar. Il réussit, malgré cet accoutrement, à se hisser sur l’estrade, suivi par ses fidèles jurés. Caroline Fourest a l’air de s’emmerder franchement. Bientôt nous saurons qui a gagné (car ils ne l’ont pas révélé sur France Culture, ils ont coupé juste avant), mais avant, la parole est à notre hôte, le président du groupe Frères Blanc. Il lit ses papiers et nous souhaite : une bonne année ; de résister à l’indifférence et à l’enlisement dans les vertus négatives de notre époque ; d’être nous-mêmes. Applaudissements. Il se vante « d’avoir résisté à l’indifférence en créant le prix Procope des Lumières dans le plus ancien café politique et littéraire de Paris », pour faire renaître l’esprit du lieu chargé d’idées souvent « impertinentes ». Il a un lapsus intéressant en déclarant vouloir perpétuer « les tirages, euh l’héritage » des philosophes des Lumières. Il est obligé de tourner sa feuille pour lire le nom des jurés. Et puis arrive le moment : Jacques Attali prend le micro, l’air chafouin et grave, comme il sait le faire. Il pontifie un peu, évoque les Grecs, les Romains, les Juifs, les Lumières. Il parle dans sa barbe et il articule mal et, d’un coup, balance le nom du vainqueur : c’est le bouquin sur les croissants chauds ! Comme il a un nom compliqué et que personne ne le connaît, on n’a pas bien entendu, mais quelques personnes applaudissent quand même. Le lauréat prend la parole, il a l’air content, il a gagné. On lui offre des croissants (tout le monde rit), un chèque de deux mille euros sur un gros carton, une invitation pour toute l’année au Procope « d’une valeur de deux mille quatre cents euros » et une bouteille de champagne de 1961 (d’une valeur inconnue, mais vu la description, l’impétrant ferait bien de la vendre sur eBay). Il est 20 heures 25 : la cérémonie est terminée. C’est l’heure du cocktail. La migration est rapide. Les vieux briscards font déjà la queue devant le saumon et le foie gras. Les membres du jury discutent entre eux, ils ont l’air fatigué. Ils décident d’aller manger ailleurs, s’en vont. Jacques Attali me bouscule pour la deuxième fois. Il est 20 heures 30. Il ne reste donc plus à l’étage que les invités (et le lauréat). Il est difficile de déceler un point commun entre tous ces gens : le mail d’invitation a, semble-t-il, circulé largement. Si le costume domine chez les hommes, je remarque plusieurs réfractaires à la bonne tenue, certains portant cheveu ébouriffé, vieux pull, chaussures informes, ce qui n’arrivera pas le lendemain, aux Deux Magots. Quant à moi, je fais la queue devant les hors d’œuvre, et me fais allègrement voler ma place par ceux qu’il faut bien se résoudre à appeler les vieux, ceux qu’une longue expérience des cocktails et des réceptions a habitués à ne plus respecter ni foi ni loi quand il s’agit de bouffer gratos. Celui du début, qui prenait deux verres de champagne, n’arrête pas de passer devant moi : il tourne entre les buffets et revient toujours avec une assiette pleine qu’il rapporte à sa femme, assise dans un coin. Il est grand, a les cheveux filasses, et un regard de bon chien fidèle. J’essaie le pâté en croûte : il est mou, mal assaisonné, la pâte feuilletée est complètement trempée. Déception ; je laisse mon assiette dans un coin. Au fil de la soirée et du champagne, je fais des rencontres étonnantes. La philosophe est toujours là ; un homme en jean et pull se tient dans un coin, l’air supérieur. Il ressemble à Jacques Rancière, mais mes souvenirs de Jacques Rancière sont trop vagues pour être sûr que ce soit lui (le lendemain, c’est l’inverse : les souvenirs de l’homme que j’ai vu au Procope sont trop vagues pour être certain que c’est le même que celui que Google Images m’identifie comme « Jacques Rancière »). Un autre tient absolument à prendre mon cornet de glace (poivron-framboise) en photo : j’accepte. En même temps, il explique à son ami, qui le suit partout, que le Nikon « ne lui a coûté que mille deux cents euros », ce qui étonne l’ami. Ils sont à trois centimètres de mon nez, mais discutent comme si je n’existais pas. Un homme m’interpelle : un peu plus tôt, je l’avais remarqué car il m’avait semblé qu’il portait deux cravates, mais je m’aperçois que j’ai été trompé par le motif. Il a la soixantaine bedonnante, le cheveu mi-long et un peu gras, de grosses lunettes à montures métalliques dorées, une odeur suave. Il se présente comme « l’homme-gadget national et international ». N’étant pas sûr d’avoir bien compris, je lui demande confirmation : il répète ces mêmes mots. L’homme me révèle être un self-made-man du gadget, avec plus de cent mille références à son catalogue. Il lance bientôt un site Internet, pour lequel « quarante chaînes de télévision » l’ont contacté pour un reportage. Comme je ne comprends toujours pas bien de quoi il s’agit, il me le montre : il sort de sa poche un petit cœur clignotant qu’il accroche au revers de ma veste. « Voilà : ça c’est le cœur, tu vois, je le vends à quinze mille exemplaires par mois, ça. » Mais à qui ? « Eh bah t’es con ou quoi ? À des congrès de chirurgiens, n’importe quoi en rapport avec le cœur. Ça fait du monde. » Effectivement. Il me propose de me fournir des gadgets « tigre » et de m’envoyer un dossier de presse. Il m’assure également qu’il ferait un bon sujet de reportage. Après quelques macarons pour la route, je m’en vais : il est 22 heures 30 ; les salles du restaurant sont toujours désertes. Le lendemain, 31 janvier : prix des Deux Magots. C’est une tout autre compagnie. Cela tient, en partie, à l’horaire : le cocktail est prévu à midi, ce qui avantage les dames chic qui ne travaillent pas (également appelées : les bourgeoises), les vieux messieurs qui ne travaillent plus, et de manière générale, les indigènes et les ressortissants de la véritable aristocratie parisienne. J’arrive un peu en avance : la salle historique des Deux Magots est réservée. Les touristes et habitués non invités sont relégués en terrasse. Cette fois, je suis sur la liste - enfin, sous le charmant pseudonyme de « Raphaël Meltz ». La non moins charmante personne qui administre les entrées ajoute mon véritable patronyme. Ici, pas de serveurs obséquieux, pas de « bienvenue au Procope, Monsieur ». On est entre soi : pas besoin de se faire signaler son pouvoir et sa légitimité puisque tout le monde le sait. Je m’installe encore à une assez bonne place, au fond à gauche, avec vue directe sur la table des délibérations, et panorama sur la salle. De gentilles grands-mères me demandent si elles peuvent prendre la banquette. D’autres sont moins sympathiques, de vraies rombières qui ont sorti leur équipement d’hiver : fourrures, boas, chapkas. Comme le soleil traverse la véranda, en moins de trois secondes, elles sortent de grosses lunettes à verres fumés. Leurs smartphones sont revêtus de peaux de lézard et de crocodile ; dedans, elles disent des choses comme : « Mais oui ma chérie, je suis aux Deux Magots, pour le prix ! Et quel temps avez-vous en Bretagne ? Il fait beau ? Ah, comme je vous envie ! » Plus loin, des femmes en tailleur de tweed aux couleurs campagnardes discutent belles-lettres - « Je ne lis plus que des livres d’histoire, j’ai découvert l’histoire sur le tard ». Les deux spécimens les plus singuliers sont assis à ma gauche, sur la banquette : deux jeunes gens qui semblent surgis des années 1930. L’un arbore un nœud papillon, des chaussettes rouges dans ses mocassins, un pantalon de velours, des petites lunettes rondes en écaille. Il porte une sorte de veste de chasse marine avec des revers rouges. L’autre a une coiffure (presque) à crans, un pull de tennis à la Gatsby. Il ne lui manque que les knickerbockers. Ils ont l’air férocement sarkozystes (plus tard, je crains qu’ils ne m’aient démasqué quand leur chef, celui aux lunettes, me demande de m’écarter d’un « Pardon, Monsieur » prononcé d’une voix de stentor ; mais il veut juste accéder aux petits fours). Les membres du jury arrivent doucement : certains sont très vieux, comme Jean-Paul Caracalla, né en 1921 et secrétaire général du prix depuis 1972. D’autres étaient déjà là, discutant avec des invités, mais je ne les avais pas reconnus. Ils s’installent à leur table. Ici, aux boutonnières des hommes, je vois : des Légion-d’honneur (rouge), des Ordre-national-du-Mérite (bleu), des chevaliers-des-Arts-et-des-Lettres (vert). On en voit aussi aux boutonnières des femmes, quand elles en ont. La vieille à qui j’ai laissé ma place, par exemple, a un ruban de chaque couleur. Pour être complet, il n’y a pas que des vieux, mais aussi des gens appartenant manifestement au « milieu » des lettres parisien : des filles élégantes, des garçons un peu moins. Les femmes sont plus beaucoup plus belles que la veille. Quelques caméras filment la scène. L’un des cameramen porte une authentique barbe de hipster assez incongrue au milieu de cet extrémisme rive-gauche : l’excentricité ici est contrôlée et s’exprime, au pire, par le port d’un pantalon de velours rose avec cravate assortie. Vers 12 heures 20, le champagne arrive : les serveurs traversent la foule qui s’est maintenant accumulée autour de la table où les jurés « délibèrent » (c’est-à-dire : se donnent des coups de coude en se faisant des blagues). Les trois livres entre lesquels ils doivent choisir sont : Le Souvenir du monde, de Michel Crépu ; Les Auto-tamponneuses, de Stéphane Hoffmann ; Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson. Le champagne est vite bu, les vieilles dames se plaignent qu’il n’y en ait pas plus. À côté de moi, le vieux couple se demande où lui aurait bien pu perdre sa « carte » : « Au Sénat ? Ou au Quai d’Orsay ? » La dame aux trois rubans me confie une tâche d’importance : je serai la vigie qui la préviendra de l’approche du champagne ; elle se chargera de héler le serveur. Et puis d’un coup, le silence se fait : Jean-Paul Caracalla s’est levé pour annoncer le nom du vainqueur. Il a un micro qu’il ne tient pas très droit, et qui n’amplifie qu’un mot sur deux. On se plaint au fond : « On n’entend rien ! », disent les tailleurs en tweed. Si : c’est Michel Crépu qui remporte le soixante-quinzième prix des Deux Magots - Michel Crépu, « le dernier catholique heureux », ainsi que le proclame le bandeau qui barre la couverture de son livre, un essai sur Chateaubriand. La salle pousse « Oh » et des « Ah » approbateurs, « Ah, c’est bien ». Et voilà, c’est fini : pas de chèque, pas de simagrées. L’auteur va quand même recevoir son prix : comme son nom l’indique, il a les cheveux frisés. Tout le monde le connaît, sauf moi : il était juste à côté. Ses filles époussettent sa veste en velours à son passage. À l’heure des petits fours, ma situation ne se révèle pas si avantageuse qu’elle ne le semblait au début. Étant placés au fond, nous devons attendre que les serveurs arrivent jusqu’à nous ; or ils doivent subir pendant la traversée de la grande salle l’abordage de multiples flibustiers qui n’hésitent pas à prendre, voire à manger, plusieurs toasts à la fois. Cela agace sérieusement mes voisines, qui sont « invitées elles aussi » et qui n’ont « rien eu ». Et quand la marchandise finit par nous être livrée, on s’aperçoit que ce n’est pas très bon. De toute façon, tout ce beau monde se disperse assez vite. Ils ont des choses à faire - « Eh bien moi je vais passer l’après-midi dans un endroit beaucoup moins glamour : l’université de Créteil. Oh, c’est moins glamour, mais c’est très bien aussi. » Je me décide à quitter les lieux, après une dernière tentative de progression vers les tartes aux framboises, que je n’atteindrai jamais. Je remarque à l’occasion quelques têtes croisées la veille : cela confirmera à qui en doutait l’existence d’un vaste complot germanopratin gouvernant les Lettres Françaises. Dehors, à côté de la grande porte à tambour, Michel Crépu discute avec une connaissance. On le photographie. Il réussit malgré tout à terminer sa citation de Joseph de Maistre : « Je ne sais pas ce que le contient le cœur d’un bandit, mais je connais celui des honnêtes gens, et c’est épouvantable. » Ils rient.