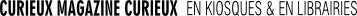


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


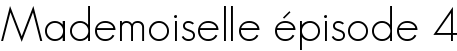
 |
|
|
Publié dans le
numéro 004 (Avril 2011)
|
En uniforme de pompier volontaire, Vincent est adossé contre l’un des piliers en bois de chêne qui délimitent le pourtour du stand, dans l’attitude de Robert Redford après qu’il ait bâti de ses mains, quelque part dans le désert hostile des Rocky Moutains, la merveilleuse cabane de Jeremiah Johnson.
A intervalles réguliers, il se décroche de son poteau pour parcourir au ralenti les quelques pas qui le séparent du poteau d’après, sur lequel il se pose, me suivant de branche en branche comme je vais de barre en barre pour arranger les vêtements selon les photos du «merchandising» envoyées ce matin par la «merchandiser» [« Merchandiser : les produits présents sur les linéaires des grandes surfaces ne sont pas disposés par hasard. Visibilité et attractivité : les deux maître-mots d’un bon emplacement ont débouché sur la création d’un métier à part entière, celui de merchandiser », lit-on sur un site d’orientation professionnelle. Après ça, peut-on continuer à dire qu’«il n’est point de sot métier» ?] Décidant de rompre la monotonie de cette étrange activité - essentiellement : intervertir l’ordre des cintres - j’annonce à mon compagnon la recette du premier jour des soldes. Il est fumé. « 35 000 euros en une journée, juste sur ton stand ? C’est ce que je déclare en deux ans ! » s’écrie-t-il en se cramponnant à son chêne.
Quand je réalise que nous sommes à découvert dans l’allée, il est déjà trop tard. Charriant à vive allure un portant à roulettes, Laurence Truissard, connue comme la-grande-cheffe-qui-mouille-la-chemise, fond sur nous telle un indien Tête-Plate chevauchant sa monture. A notre hauteur, elle pose sur mon camarade un regard chargé de courroux, et me décoche : « Vous avez une cliente qui attend en cabine ». Instantanément, Jeremiah Johnson s’éloigne avec docilité - la queue basse, dirait Raphaël Meltz.
La frénésie des soldes à peine retombée et déjà la fièvre des nouvelles collections, attisée par la publication des «must have» dans les magazines féminins (« cette saison, on veut toutes un teddy en cuir bicolore ! »). Au téléphone, « Non madame, je ne l’ai pas encore reçu », répond Cindy pour la huitième fois d’affilée tandis que, perverse, je glisse à Aurelia Monteanu qu’« il va arriver d’un jour à l’autre... », juste pour vérifier si le « tumulte d’angoisse suscité par l’attente de l’être aimé, au gré de menus retards » dont parle Barthes peut, le cas échéant, s’appliquer à un teddy en cuir bicolore. Si je vais un peu plus loin dans les Fragments d’un discours amoureux, je commence à me sentir sérieusement concernée : « partout où il y a attente [d’un must have], il y a transfert [sur la vendeuse] : je [Barthes se met ici dans la peau de la cliente] dépends d’une présence qui se partage et met du temps à se donner [retard de livraison] - comme s’il s’agissait de faire tomber mon désir, de lasser mon besoin [du teddy]. Faire attendre [de la part de la vendeuse] : prérogative constante de tout pouvoir ».
Sale coup : je suis objet de transferts multiples. Soudain, je vois clair dans leur jeu, à ces fayottes qui achètent des nu-pieds en févier et me susurrent d’une voix mielleuse : « Je les prends maintenant parce que ça part tellement vite, chez vous ! » Démasquées, les manipulatrices qui espèrent me faire culpabiliser pour un pantalon (« Oh non... j’ai laissé mes enfants tous seuls pour venir et vous, vous ne l’avez pas... »). Quant à celles qui donnent libre cours à leurs pulsions agressives, comme cette quadragénaire anglaise qui, parce que je n’avais plus sa taille, avait brandi son majeur en s’époumonant d’un « Fuck you ! », elles ont au moins le mérite d’être franches du collier.
En cette période reviennent aussi les «bonnes clientes», qui ne sont pas celles dites «des soldes» (le menu fretin), sans entrer dans le lot des «exigeantes», les riches et méchantes. « Elle est blindée mais elle est bien élevée, très sympathique ! », s’étonne Cindy à chaque fois qu’elle rencontre un de ces spécimens. Dans cette catégorie, ma préférée : See, une jeune Coréenne qui plusieurs fois par an vient faire le plein de vêtements qu’elle revend à Séoul. Au passage, elle me laisse parfois des cadeaux, miniatures de costumes traditionnels coréens servant de marque pages ou boîtes géantes de macarons. Nous communiquons dans un vague anglais qu’elle prononce comme si elle avait une pomme de terre brûlante dans la bouche (« Hhhi ! Hhhow hhhare you ? ») mais quand elle me rend visite, elle me serre dans ses bras, me prend par la main et m’entraine dans d’étourdissants tours de stand. Pas de See aujourd’hui, mais Stéphanie Chouchan, la grande rivale et cousine par alliance de Sophie Mimoun. « Tu vas bien ? », me demande-t-elle de sa voix lascive sans cesser de feuilleter le catalogue du défilé, avant de pointer un ongle manucuré sur la photo d’un short en jean lacé à la taille : « Lui, je l’ai aimé. Je l’ai pris dans toutes les couleurs. Pour la plage à Eilat ». Alors qu’elle parade en sous-vêtements de la cabine au miroir entre deux essayages, elle tombe nez à nez avec Dany Levy, une sombre douairière pour qui tout, de la crise financière à la météo pluvieuse pendant son séjour à Miami, est source de tracas et de nuits d’insomnie. Comme la princesse des Laumes rencontrant à contrecœur Mme de Gallardon, Stéphanie Chouchan fait un salut désinvolte à sa sinistre connaissance et, un peu dédaigneuse, la complimente d’un mot sur le récent mariage de sa fille. « Elle ça va, elle a fait un beau mariage, convient Dany Levy. Par contre, Deborah... »
Dans la minuscule réserve en face de la mienne, Coco et Vivienne, des anciennes des Galeries, prennent leur pause déjeuner assises sur des marchepieds, au milieu des piles de cartons et de boîtes à chaussures. Elles mangent ce qu’elles ont apporté de chez elles, des œufs durs, des sandwiches au jambon, de la soupe dans des thermos. Je leur demande si elles vont à la fête de ce soir au Cirque Grüss, sur la pelouse de Saint-Cloud. « Et comment on rentre, nous, après ? En taxi c’est trop cher, on habite loin, répond Vivienne en épluchant sa clémentine. Une soirée au cirque, pfff... Ils croient qu’on a quel âge ? Huit ans ? ». Coco ajoute d’un air gourmand : « Mais tu vas voir, les fêtes des Galeries, c’est chaud bouillant... »
Avant ma pause, je fais un crochet par les toilettes du personnel. Deux femmes de ménage en uniformes bleus et sabots blancs discutent en portugais en vaquant à leurs occupations : la Noire passe la serpillère tandis que la Blanche presse ses points noirs devant le miroir. Pendant que je me lave les mains, elles me lancent des petits coups d’œil en coin.
« Faîtes voir votre robe ! » Je sursaute. « Votre robe ! Faites voir ! » Une femme bondit de derrière un poteau et atterrit sur ma gauche. Je me tourne vers elle avec l’intention d’entamer un dialogue... « Ah non ! C’est beaucoup trop court pour moi » s’exclame la tonitruante sur un ton de reproche avant de disparaître aussitôt, sans avoir une seconde croisé mon regard.
Deux fausses blondes richement vêtues font le tour du stand en passant en revue les habits sur cintres. « Elles, c’est des Gitanes, me dit doucement Cindy. Ecoute leur accent ». J’écoute, je n’entends rien de spécial. Cindy sourit : « C’est parce que t’as pas l’habitude ». Elle me raconte son adolescence à Montfermeil avec sa meilleure amie de collège. « On se ressemblait tellement, on aurait dit deux sœurs. J’allais tout le temps dormir chez elle, dans la caravane. C’est comme ça que j’ai rencontré son cousin, le père de mes enfants. Quand on s’est marié j’avais même pas dix-huit ans ». Chez les Gitans, la coutume veut que le jeune homme enlève sa fiancée et qu’ils s’enfuient ensemble, peu importe la destination ni la durée du rapt - pour eux : une nuit d’hôtel à Disneyland, Seine et Marne. Puis ils doivent revenir et «se faire pardonner», me dit-elle. « Le père, il peut reprendre sa fille. Ou des fois les familles disent non si c’est des mariages mixtes. Mais eux ça allait, ils étaient ouverts. Et même si j’étais une gagdi, pour ses parents j’étais comme leur fille. Alors on est rentré et on a fait une grande fête sur la place. A l’époque, on avait une 205 et une caravane pourries mais on s’en foutait, on était toujours dehors, ou sur la route. Dehors, c’est la plus belle vie... Et petit à petit on a eu de l’oseille, on a grossi ». Cindy me décrit leur dernière caravane de vingt-cinq mètres carrés avec cuisine équipée, qu’ils avaient installée dans le jardin de leur maison à Montfermeil. « On avait toutes nos affaires dans la baraque mais on vivait dans la caravane : un vrai Gitan, jamais tu le feras dormir ailleurs ! » Evidemment, je ne vous dis pas tout, seulement le côté solaire de l’histoire - rien des heures sombres, elles ne regardent qu’elle.
En tenue de fête, Elena, la chef de rayon, vient nous donner les dernières consignes pour ce soir : « Si vous faites la fermeture à 20 heures, dépêchez-vous, ils ferment les portes à 21 heures tapantes. Et n’oubliez pas vos badges employés : contrôle des numéros de pointage à l’entrée ».
Plus personne à l’horizon. Je reçois un coup de fil sur mon portable : c’est Aurélie Delafond qui doit être en train de boucler le dernier numéro du Tigre. Je m’enferme dans la cabine du fond pour répondre. On parle depuis quelques minutes quand le rideau s’ouvre d’un coup sec : « Vous êtes la vendeuse ? Je viens faire un rendu ».
Nuit noire, il pleut sur le boulevard Haussmann désert. Je rejoins Nisrine, Sylvia, Chloé et Soizic à la borne de taxis devant les vitrines. J’ai perdu mon badge, l’heure tourne et quand se présente enfin un taxi de huit places, je grille la priorité à une famille d’Allemands chargés de sacs Galeries. A l’arrière de la fourgonnette, Chloé tourne son minois potelé vers moi pour me dire en riant : « Au fait, les femmes de ménage tout à l’heure : elles parlaient de toi en portugais. Y’en a une qui a dit «Dis-donc, elle est courte sa robe !» Et l’autre, elle a répondu : «Qu’est-ce que tu veux... Les filles, de nos jours, elles aiment bien montrer leur chatte» ».
J’ouvre le carton d’invitation. Ecrit en blanc dans une étoile rouge sur fond or :
Annie Bois
Directrice Business Unit Galeries Lafayette Paris Haussmann
a le plaisir de vous inviter
pour célébrer ensemble
les résultats exceptionnels
de 2010
Au bois de Boulogne, les contours flous du grand chapiteau se dessinent comme sous un calque dans les vapeurs blanches de brouillard. La foule se presse devant les bâches où des agents de sécurité font entrer au compte-goutte, sans vérifier les badges car nous sommes en retard ! En retard ! En retard ! Nous nous engouffrons dans cette tanière en suivant le tapis rouge de l’allée, longeons l’interminable enfilade de vestiaires qui mène jusqu’à une tenture de velours rouge elle aussi, la frontière écarlate entre un couloir glacial et le pays des merveilles. De l’autre côté du rideau, des hommes et des femmes en costumes noirs et écharpes blanches nous font une haie d’honneur en applaudissant à notre passage. « C’est qui ces blaireaux ? - La direction », chuchote Nisrine en me faisant les gros yeux. Un serveur en livrée me met une coupe de champagne entre les mains, derrière Sylvia je me laisse porter par le courant, dans le flot des visages j’en reconnais certains - la dame de la cantine sans sa petite toque, le réparateur des caisses avec un gros nœud papillon - une hôtesse écarte une tenture semblable à l’autre tandis qu’un serveur en livrée m’enlève des mains la coupe de champagne. Sous le chapiteau, quelques places libres tout en haut des gradins. Les lumières s’éteignent, un halo de lumière tombe sur l’arène.
« On ne peut pas dissocier la vie du rêve » entonne Alexis Grüss tandis que derrière lui, dans l’ombre, on distingue les silhouettes de «la direction». « Ce soir, vous allez rêver les yeux ouverts, et vous n’allez pas cesser d’applaudir : il n’y a que des artistes ici, c’est le point commun entre le Cirque Grüss et les Galeries Lafayette. Oui ! Vous, vous tous, vous êtes des artistes cartous ensemble vous avez fait de votre magasin le plus grand magasin du monde en terme de chiffre d’affaires ! Un milliard deux cent millions d’euros en 2010 ! Vous l’avez fait ! Bravo ! » Un petit poney nommé Lafayette vient faire la révérence, suivi de près par une cohorte d’écharpes blanches qui nous invitent à « rêver les yeux ouverts » et à « reproduire ce record de performances en 2011 », jusqu’au mot de la fin d’Annie Bois : « Merci pour cette année absolument magique en terme de chiffre d’affaires... Place au cirque ! ». Un cheval, deux chevaux, trois chevaux, le poney Lafayette et l’ensemble de la famille Grüss galopent sous les flonflons dans toutes les positions possibles. Quand les portes s’ouvrent enfin, nous laissons Annie Bois et les cols blancs, parmi lesquels je reconnais la fétichiste du badge Véronique Sauvet, se déhancher maladroitement sur la piste encore humide de la sueur des bêtes.
Ailleurs la foule danse beaucoup mieux, sur du drum and bass et des rythmes jungle. Aux vibrations des percussions répondent les spasmes de trois saxophonistes perchés sur une scène suspendue dans un nuage de fumée orange, comme dans le bal gothique de L’Ange de la vengeance. Un petit groupe en cercle improvise une battle de break-dance à côté d’un vigile de la Spéciale qui regarde sa femme onduler sur un podium. Je renverse trois coupes de champagne sur les chaussures de fête d’Elena, dans les éclairs saccadés des stroboscopes Chloé et Sylvia on l’air de poupées désarticulées, Laurence Truissard attrape Nisrine par la taille et lui susurre « Viens, on va boire ». Quelqu’un me mord dans le cou. Je me retourne : c’est Jeremiah Johnson.