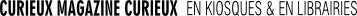


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


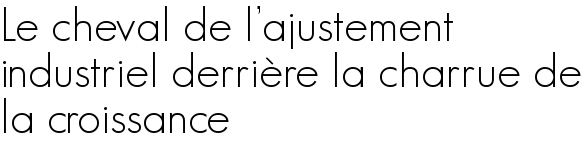
 |
|
|
Publié dans le
numéro 003 (Mars 2011)
|
Il est doux, par un jour d’hiver blanc et vide, de flâner quelques heures dans une galerie commerciale. Tout est propre, climatisé. L’électricité dispense démocratiquement une lumière jaune sur les articles en solde et les clients ravis. Le sol est lisse : avec un peu d’élan, on parcourt plusieurs mètres de la façon la plus divertissante qui soit, en glissant.
À cette heure-ci pourtant (9 heures du matin), personne ne glisse le long des couloirs souterrains du Carrousel du Louvre ; personne ne remonte à contre-courant les escalators ; et il n’y a pas grand monde autour de la pyramide inverse de Pei. Ça ne doit pas être le moment. Dédaignant les instants shopping et les pauses gourmandes, des hommes pressés suivent les flèches « Coface » et convergent vers le hall Charles V.
Un lieu chargé d’histoire, hein : Charles V, c’est le roi de France qui fit bâtir l’enceinte dont il reste ici quelques pierres. Cette luxueuse galerie commerciale est donc à peu près située dans le fossé qui bordait Paris il y a 600 ans. Sapristi, voilà qui donne à réfléchir...
pause méditative
Bon, et Coface ? Le nom est plus mystérieux. Cela pourrait aussi bien être un médicament (« Coface, 20 comprimés pelliculés sécables, voie orale ») qu’une alliance entre États (« réunion de la Coface à Genève »)... Le logo, un globe terrestre bleu traversé d’un triangle rouge, fait penser quant à lui à une nouvelle arme. Une arme à l’échelle du globe, une énorme bombe atomique ? D’ailleurs, le titre exact de l’évènement qui a lieu ici est Colloque Coface Risque Pays (avec quatre majuscules : ça ne rigole pas).
Sauf que non : le sous-titre annonce « Toutes les tendances de l’économie mondiale en une journée ». Coface, c’est donc plutôt, pour développer son acronyme, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. Créée par l’État au lendemain de la Libération pour couvrir les risques des exportateurs français, c’est aujourd’hui une merveilleuse entreprise mondialisée, privatisée en 1994, filiale à 100 % de la banque Natixis, qui propose « à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur secteur d’activité et leur nationalité, une gamme complète et modulable de prestations pour optimiser la gestion de leur poste clients. »
L’une de ces prestations est la notation de pays : en fonction du risque moyen d’impayés présenté par les entreprises d’un pays, Coface attribue une note. A1 pour les bons élèves (« situation politique et économique très favorable, environnement des affaires de qualité [...], probabilité moyenne de défaut très faible »), puis A2, A3, A4, B, C ou D (« les perspectives économiques et politiques présentent des risques très élevés et l’environnement des affaires peut être très difficile. (...) La probabilité moyenne de défaut est très élevée. »).
En règle générale, des endroits comme la Suisse, la Norvège ou le Canada (A1) sont jugés plus sûrs pour les affaires que l’Afghanistan, l’Iran ou l’Irak (D). Pour d’autres pays, c’est moins évident. Est-ce par exemple le bon moment pour conclure quelques contrats en Tunisie ? Quelles opportunités de développement offrent la Chine, l’Inde, la Russie ? C’est à ce genre de questions cruciales que le colloque d’aujourd’hui va m’apporter des réponses.
Renault, PSA, Michelin, Total, Air France, Airbus, Eurocopter, Vinci, Sanofi-Aventis, Bayer, BNP-Paribas, Bred, Natixis... vu la liste des participants, on est en bonne compagnie : comme tous les ans depuis 1995, il y a là plus d’un millier de décideurs en provenance des grandes sociétés françaises et européennes.
Pour le moment, ils font la queue pour recevoir des mains d’une hôtesse en tailleur-foulard un badge (nom, entreprise), une sacoche Coface et des écouteurs pour la traduction des interventions. L’apparence de tous ces gens, lisse à l’extrême, correspond étrangement à mes préjugés sur les cadres : les hommes sont rasés de près, les femmes (assez rares) ont les cheveux attachés. Il y a des chauves en forte proportion ; des costumes gris, des cravates fantaisie, et des serviettes en cuir par centaines.
La salle où se tient la conférence est un compromis entre le hangar et le stade de foot. Des gradins en pente douce entourent une scène oblongue, presque un quai, qui doit servir habituellement à des défilés de mode. On a disposé là-dessus un pupitre en forme de vague et six fauteuils cubiques. Aux murs, neuf (neuf !) grands écrans.
Je choisis une place au dernier rang, pour dominer un tant soit peu la situation. Dans la salle bien remplie, je relève deux vestes orange. Puis je m’emploie à faire l’inventaire de ma sacoche Coface : programme, communiqué de presse, dossier participant, présentation des intervenants, Guide Coface Risque Pays 2011 (là encore, pléthore de majuscules), plus Cofamag et un stylo-bille doré...
La charte graphique du colloque, plutôt austère, tient en deux polices (Times, Helvetica) et trois couleurs (violet, gris, marron). Les couleurs vives semblent réservées aux logos des partenaires et aux courbes de risques. Sur la couverture des brochures, des titres bilingues et un même visuel. On y voit quelques gratte-ciels, une jeune femme censément dynamique (debout, chignon, un ordinateur dans les bras) et deux petites fleurs, le tout passé dans Photoshop au filtre « Aquarelle ». Fausse simplicité : en observant l’œuvre de plus près, l’amateur découvrira d’admirables détails cachés ― une flèche d’ascenseur dirigée vers le haut, des chiffres à virgule, un graphique de tableur... J’imagine qu’on a demandé à l’artiste d’exprimer les idées de modernité, de compétitivité et de développement durable.
Le noir se fait. Lumière sur François David, ci-devant président de Coface : bienvenue, blablabla... 2011, année de croissance, blablabla... faire mentir les tenants de l’Apocalypse... Et tout de suite des chiffres - des 4 %, des 3,4 % - qui ne m’évoquent rien. C’est parti pour une journée de macroéconomie abstraite.
Le colloque attache le plus grand soin à la qualité des intervenants : dans le programme, les titres universitaires du deuxième orateur ne peuvent être résumés en moins de trois lignes. Raghuram Rajan est donc « Eric J. Gleacher Distinguished Service Professor of Finance at the University of Chicago Booth School of Business », qu’on se le dise. Après lui interviendront d’autres professeurs, journalistes et patrons aux CV bardés de diplômes, de livres et de décorations. Tenez, François David par exemple : à bientôt 70 ans, il est commandeur de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite, officier du Mérite agricole et officier dans l’ordre de Saint-Charles (une distinction monégasque). Respect.
Raghuram Rajan, lui, n’a d’autre médaille qu’un prix d’économie. Il parle d’abondance, mâchonnant son anglais sans égard pour les présomptueux qui comme moi ont négligé de s’équiper de l’appareil de traduction. Ma voisine quinquagénaire se bat justement avec ce bidule, une sorte de stéthoscope doté d’une molette à 20 positions. Position 1 : anglais ; position 2 : français ; positions 3, 4, 5... 20 : silence. À ma droite, dans un box, trois personnes se relaient pour traduire.
Je saisis quand même quelques mots au vol : « massive fiscal stimulus », « large amount of cash », « unemployment crisis », « double dip ». Important, le double dip : pendant toute la journée, les intervenants ne cesseront d’y revenir, généralement pour l’écarter comme une sombre perspective. Il ne semble pas exister d’équivalent à ce terme en français [1].
À peine cinq minutes et j’ai décroché : le bruit de feuilles tournées avec un bel ensemble réveille mon attention. Il y a donc un support écrit, des documents qui permettront peut-être de décrypter ces discours. En fait de documents, l’épaisse brochure sur papier glacé ne propose qu’un catalogue des diapos bilingues déjà diffusées sur grand écran.
Ces « slides », comme on dit ici, partagent la même présentation sommaire, probablement due à PowerPoint : blanches, avec une zone pour le titre en haut, du texte ou un graphique en bas, ces deux parties étant séparés par une ligne violette et une ombre portée dégueulasse.
Il y a quelques mois, plusieurs journaux avaient signalé la parution d’un livre qui s’inquiétait de la généralisation du PowerPoint comme substitut au discours dans les entreprises :
La pensée PowerPoint. Enquête sur ce logiciel qui rend stupide, de Franck Frommer, La Découverte, 2010
Comme l’auteur de ce livre, on peut considérer que les diapos créées avec ce logiciel ne proposent que des phrases hachées, scandées par d’innombrables puces et flèches pour donner une illusion d’argumentation.
On peut aussi y voir une poésie toute contemporaine et quelque peu hermétique, sans rythme ni rime. Fragment :
Une
idée académique.
La transition est un cauchemar.
Trop
d’importance accordée aux taux de change.
La compétitivité
dépend des données structurelles,
dont l’efficacité du
système bancaire
Brisant l’alternance monotone de phrases, de courbes et de camemberts, l’une des slides produit un sacré choc visuel. Elle montre deux photos - une plateforme pétrolière et un morceau de gouda -, surmontées de ce titre : « Non envisagé : le risque de la maladie hollandaise ». Une petite flèche va de la plateforme au fromage, laissant entendre un lien de cause à effet, une métamorphose peut-être.
Rien dans le discours de Michael Hüther (« director and member of the main board, Cologne Institute for Economic Research »), ne laissait présager une telle apparition. Est-ce la mer ? l’ombre bleue des montagnes, derrière les grues ? est-ce la croute orange du gouda, pourtant peu appétissante, ou la toile cirée mouillée sur laquelle il repose ? Quoi qu’il en soit, la rencontre fortuite de ces objets bien concrets emmène l’esprit bien loin des histoires de rendements, de dette souveraine et de primes de risques [2].
Pourtant, personne n’a l’air choqué dans la salle. Les mêmes visages impassibles, concentrés. Sauf peut-être cette dame à la bouche grande ouverte, comme asphyxiée - ou ce type là-bas, qui se prend la tête à deux mains... Je me demande ce qu’il faudrait pour interrompre la conférence : un lapsus obscène, un blanc qui s’éternise, des experts qui se tapent dessus... Mais non, les orateurs évitent souplement les pièges de la rhétorique, restent courtois même quand le débat s’anime. « J’ai bien aimé l’avant-dernière slide de Tito », fayote une banquière à la voix de petite fille, en rajustant ses cheveux derrière ses oreilles. « On met le cheval de l’ajustement industriel derrière la charrue de la croissance », s’inquiète gravement un économiste.
Pause café. Au cas où certains se seraient assoupis, une petite mélodie oppressante est diffusée en boucle. La plupart des participants semblent se retrouver en vieilles connaissances. Deux Allemands, l’air préoccupé : « ... kein Geld mehr. Warum ? » Ceux qui sont tout seuls sortent leur iPhone ou leur Blackberry. Je pars explorer les chiottes.
C’est probablement l’idée qu’un designer se fait des toilettes d’un endroit prestigieux : un air d’opéra comme musique d’ambiance, des miroirs entourés de lourds cadres dorés et sur le mur du fond, des bourgeois flamands du XVIIe siècle (on est au Louvre, té !). Sous leur regard débonnaire, une rangée de costumes-cravates occupe les pissotières.
À la reprise, je mets la main sur un appareil de traduction. C’était bien la peine : les prochains intervenants - Laurence Parisot, Louis Gallois et Patrick Artus - parlent tous français. La première commence par souhaiter « une très bonne année 2011 et un bon carnet de commandes bien rempli ». Puis enchaîne, très à son affaire, avec le coût de la main-d’œuvre, « bien plus élevé en France qu’en Allemagne, un vrai enjeu ». Les deux autres échangent mollement des considérations sur la Chine et l’Inde jusqu’à l’heure règlementaire, 12 h 45. On migre alors vers la salle Delorme, une sorte de gymnase violemment éclairé.
J’espérais que le déjeuner serait un buffet, ce qui m’aurait permis de vaguer en espionnant les conversations. Raté : c’est un repas assis, placement libre. Les tables proches de l’entrée sont bien remplies ; vers le fond, elles se font clairsemées ; certains mangent seuls... Je peux ? Mais bien sûr, s’empresse un monsieur brun et joufflu, qui, voyant mon air égaré, décide de me prendre sous son aile.
Responsable administratif chez un gros producteur laitier, lui a été ravi par les débats du matin, riches et beaucoup moins abscons que l’année dernière (« oh, l’année dernière ! », confirme son collègue). Selon lui, ce « décryptage » des grandes tendances de l’économie mondiale justifie amplement le prix de la journée - 900 euros par personne, comme je l’apprends à cette occasion. Voilà qui explique sans doute la nappe blanche, les épaisses serviettes en tissu, les trois verres et les couverts en pagaille.
Le pâté de tête arrive. Christine Lagarde, l’invitée d’honneur, s’est fait excuser, mais a trouvé le temps d’enregistrer son speech devant une caméra. La diffusion de la vidéo reste un moment un peu solennel : toute la salle se recueille, tournée vers l’écran. À part une introduction adaptée aux circonstances, la ministre déroule son texte, parsemé de mots anglais et de jokes cryptiques, avec la raideur qu’on lui connait.
Le plat suivant semble être du poulet (ou bien est-ce du poisson ? la forme en amande ne permet pas de le déterminer avec certitude) avec une quiche de légumes. Mon voisin, intarissable, a bien aimé la table ronde sur la bulle des matières premières... Le grand risque de cette bulle, vous comprenez, c’est qu’elle influe sur le prix de toutes les denrées alimentaires, engendrant dans certains pays des émeutes de la faim. (Il a l’air sincèrement inquiet.) Puis il parle Monet, politique, relations humaines. Il parle même de la révolution en Tunisie avec sympathie, sans le moindre propos cynique sur les affaires qu’on va pouvoir y faire. Bref, pas un bon client.
Après la tarte aux pommes, mes notes sont plus lacunaires. Les débats ont dû reprendre. Je lis croissance robuste BRIC dette des collectivités locales en Chine renforcement de la solvabilité et de la liquidité internes flux de portefeuille entreprises résilientes le PIB mondial s’est contracté tendances parcellaires fonds spéculatifs relocalisation d’actifs passage de BAL2 à BAL3 transferts dynamiques encore une bonne année. Sur les grands écrans de la salle, les courbes se superposent jusqu’à l’illisible.
Parlant de la chute de Ben Ali, un orateur a quand même un joli mot : « La question principale - enfin, l’une des questions principales - est : est-ce que cela va changer notre manière de faire des affaires ? ». Sa réponse est hélas un peu vague. Il se dit plutôt optimiste, mais estime que la « transition démocratique » risque de prendre du temps. La Tunisie garde son A4. Je ne sais toujours pas où il faut investir. Dans le métro du retour je commence Cofamag.
[1] En fait, il s'agit d'une récession en « double creux ». On croit qu'on est sorti de la récession, on remonte la courbe, mais crac. Double dip.
[2] Renseignement pris, la maladie hollandaise, ou « mal hollandais », est un classique de l'économie. Ainsi nommé parce qu'on a commencé à l'étudier à propos des Pays-Bas dans les années 1960, il est caractéristique des pays bénéficiant d'une rente liée à l'exportation de matières premières (pour le Pays-Bas, le pétrole et le gaz de la mer du Nord). Les revenus de la rente sont réinvestis dans le secteur exportateur compétitif, provoquant un désinvestissement dans le reste de l'économie du pays, qui peut s'avérer dangereux quand la ressource naturelle vient à se tarir. La Norvège offre un bon contre-exemple à la théorie du mal hollandais.