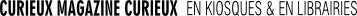


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


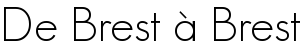
 |
|
|
|
Publié dans le
numéro 11-12 (Juillet-août 2010)
|
Avant de partir de Brest (France), il fallait encore y arriver. Les aléas de l’agenda, les tarifs des trains disponibles, la satisfaction tout arithmétique d’entamer un reportage de plusieurs jours à minuit pétante : tout cela m’a décidé (SP) à arriver à Brest par le train du lundi arrivant à 23h55, cinq minutes avant l’entrée dans le mardi fatidique. Retrouvailles prévues un peu moins à l’ouest le lendemain avec RM.
Mardi, 0h05 : Sortie de la gare. Je n’ai pas osé encore confectionner de panneau « Saint-Brieuc » ni « Guinguamp » ni « Morlaix » : le train dont je descends est passé par toutes ces villes, autant éviter d’être pris pour un fou. Quelques kilomètres à pied. Des lumières au loin : c’est l’espace Vauban. Le cinéma multiplex ferme, des jeunes en sortent. Bref espoir qu’un d’entre eux me fasse au moins décoller jusqu’au prochain patelin. « On est à pied, on habite juste là ! », éclatent de rire deux types qui me voient lever le pouce. Il est 0h15, cette fois le reportage à 100 euros a commencé, RM moisira demain toute la journée sur l’aire d’autoroute où nous avons rendez-vous près de Caen si je n’arrive pas à le rejoindre. Je sors une feuille blanche et j’écris au feutre : MORLAIX. A l’entrée de la quatre voies, la troisième voiture est la bonne.
Gérard et Sylvain, la cinquantaine, sortent d’un concert d’hommage à un saxophoniste brestois et rentrent chez eux à Plounéour-Ménez, dans les monts d’Arrée. Gérard vit de menus bricolages, Sylvain est couvreur, au chômage. Ils roulent dans une petite voiture qui ne paie pas de mine. Je leur révèle qu’ils sont les premiers intercesseurs d’une série qui doit nous mener jusqu’en Biélorussie. « Ah, tu fais le Brest-Brest », me devance Gérard, aussi peu impressionné que si je rentrais à Plouescat - sans doute parce que lui aussi a fait du stop, jusqu’au nord de l’Écosse. Heureusement Sylvain trouve un peu d’allure au projet. C’est l’heure de départ, cependant, qui l’étonne. Gérard, compréhensif : « Remarque t’as raison, tu gagnes huit heures par rapport à un départ demain matin ». Ils quittent la quatre voies 20km avant Morlaix, me déposent à une station service éteinte. Pas la moindre voiture en vue, crachin. Je me roule dans mon sac de couchage contre les portes automatiques de la boutique, sur l’unique bout de macadam abrité par un auvent. Sms à RM : « C’est parti, suis près de Morlaix. » - « Super. Serai demain à 9h30 à l’aire de Gargeville, près de Caen. »
Mardi, 6h00. L’employé ouvre le volet de la station, me salue d’une voix enjouée : « Bien dormi ? ». Première dépense sur les cent euros : un café (1,30€). Que je prends au comptoir à côté de Gérald, camion Volvo, premier routier de la journée à s’arrêter à la station. Il est 6h15, nous repartons ensemble. Il voyage à vide, va charger des cartons à recycler à Rennes. Il a roulé vingt ans à l’international avant de revenir à des trajets exclusivement régionaux. La seule fois où il a pris des autostoppeurs avant moi, les types sont partis avec deux sacs de vêtements neufs qu’il venait d’acheter. Son patron ne va-t-il pas l’engueuler s’il apprend qu’il a pris quelqu’un à bord ? Regard amusé : « C’est moi qui suis dans le camion ou c’est lui ? Il est même pas levé à cette heure ! » Deux minutes plus tard le portable de Gérald sonne : c’est le patron. Je parle des délais de plus en plus impossibles imposés à beaucoup de routiers, Gérald me dit que ce n’est pas son cas. « Moi mon patron, on dirait même pas un patron, il préfère refuser des contrats plutôt que de s’engager à des trucs impossibles. Après, si des mecs se retrouvent à faire des trucs débiles, c’est leur faute. C’est eux qui sont derrière le volant, c’est pas leur patron. Ils ont qu’à dire non. » Il convient quand même que le métier se dégrade. « Avant t’avais un pépin, le premier camion qui passait s’arrêtait sur le bas-côté pour te dépanner. Aujourd’hui tu peux toujours crever ».
Mardi, 8h20. Descente à la sortie Guinguamp/Lannion, sur un rond-point qui m’inspire peu. Pourtant une nouvelle voiture me cueille presque aussitôt. J’en reviens à peine, j’aime les Bretons, j’aime la Bretagne, jamais trajet en stop n’a été aussi simple, Christophe me dit bonjour, me dit venez, il est arboriculteur, la cinquantaine encore, il cultive des pommes à cidre plus commodes à traiter que les pommes à couteau qui requièrent dix traitements aux pesticides, ce n’est pas tellement que le cultivateur de pommes à couteau aime les pesticides mais le consommateur est ainsi fait, il voit une tache sur sa pomme il n’en veut plus, elle est bonne pour la poubelle alors que voulez-vous, avant les pommes Christophe a fait dans les cochons, au Québec d’abord pendant 8 ans puis en Bretagne, il y a quatre ans l’occasion s’est présentée de se lancer dans les pommes alors Christophe a dit banco, a-t-il bien fait il croit que oui, aujourd’hui son affaire roule, au moment de la cueillette il embauche jusqu’à douze gars pour l’aider, rares sont ceux qui supportent le boulot alors forcément ça tourne et Christophe me parle des renards et des chevreuils qui viennent se réfugier dans ses vergers où les chasseurs ne peuvent pas les poursuivre, me parle des lièvres de 50 kilos qui viennent la nuit se poster devant les phares de son tracteur et de mille choses encore, Christophe me dépose et je suis toujours à Lamballe et RM m’attend depuis deux heures déjà sur son aire d’autoroute près de Caen, alors après Christophe il y a Jean-Michel, de nouveau un homme seul, Jean-Michel dans son 40 tonnes Renault d’une compagnie basée à Tournai, en Belgique, Jean-Michel avec qui je fais deux cent bornes en parlant des élections belges qui approchent, de sa fille prof de religion à Tournai, de sa femme orthophoniste et des combines qui existent pour trafiquer le limiteur de vitesse, « tu l’étalonnes avec des pneus usés et puis aussitôt après tu remets des pneus neufs, avec l’épaisseur de la gomme le diamètre des roues est plus grand et tu grattes au moins 3 km/h, au lieu de 90 tu montes à 93, l’air de rien sur 2000 bornes ça compte », je suis seulement le deuxième autostoppeur de Jean-Michel en 28 ans de route et il semble content, il ne veut plus tellement que je descende et m’emmènerait presque avec lui livrer ses clients avant de continuer le lendemain sur la Belgique, j’invoque RM à Gargeville, je descends, hop, de nouveau le macadam, de nouveau l’attente, plus longue cette fois, remonte une heure et demie plus tard avec Nicolas qui est attaché commercial et qui roule à 160, 160 ça m’arrange bien car RM est là, je le vois, enfin, aire de Gargeville : mardi, 15h00, 98,70 euros en poche.
Être deux autostoppeurs au lieu d’un seul va-t-il améliorer ou ralentir la cadence ? L’autostoppeur assassin psychopate a plutôt tendance à voyager seul : un bon point. Les routiers qui roulent à deux n’ont plus qu’une seule place dans leur camion : un mauvais point. Match nul. Le redémarrage est difficile. J’adopte (RM) une stratégie, celle du délit de faciès à l’envers : seules les bonnes gueules sont susceptibles de prendre, donc on évite par principe les couples de retraités renfrognés, les hommes patibulaires et les femmes stressées. Gain de temps et d’énergie - sans parler du moral auquel ce principe épargne bien des vestes inutiles. J’avise justement une caisse un peu pourrie et son pilote qui prend de l’essence. C’est oui : Farid range un instrument de musique dans son coffre, plus petit qu’une guitare, plus rebondi qu’un violon, pas si petit tout de même qu’un ukulélé. « Vous faites du banjo ? » se jette à l’eau SP. Farid s’excuse : « J’écoute une émission sur France Culture, j’aimerais bien entendre la fin. » Il y a des clichés qui tiennent la route : bercés par la voix du neurologue Lionel Naccache, on s’assoupit. L’émission se termine, Farid éteint le poste. Nous jette un regard en coin, à prêt à reporter sur la conversation toute l’énergie qu’il mettait à se passionner pour le professeur Naccache. Chez les paires de vieux briscards autostoppeurs, rodés par des milliers de kilomètres en duo, un relais se prend instinctivement, sans qu’aucun signe ait besoin d’être échangé : l’un ou l’autre se dévoue et couvre son acolyte, qui dès les premiers mots de l’éveillé comprend qu’il peut se remettre à écraser une bonne heure. N’ayant encore que quelques bornes à notre compteur commun, comme des bleus, nous nous sacrifions de concert. Bien nous en prend. Car Farid est vif, bavard – problablement le type le plus incroyable qu’il nous sera donné de rencontrer. L’instrument dans son coffre n’est pas un banjo, c’est un kamânche, violon iranien, Farid est en train d’apprendre à en jouer, il joue déjà du violon, de la guitare, des tablas - de tout ce qui a cordes ou membranes ou produit un son, en fait. On ne connaît pas le kamânche ? « C’est un peu comme le sarangi, je crois », tente SP. Farid se veut conciliant, oui c’est un peu comme le sarangi c’est vrai, sauf que le sarangi c’est indien, et la musique indienne et la musique iranienne vu de loin ça a beau se ressembler, en réalité c’est différent, ce sont des rythmes différents, des énergies différentes, même si fondamentalement elles ont en commun d’être infiniment plus complexes et passionnantes que la musique occidentale, là-dessus y a pas photo. « Franchement des fois je les écoute les types qui font leur petit rock là, qui jouent leur hard ou leur métal, j’ai envie de leur dire c’est bien les mecs, c’est sympa ce que vous faites, mais ça vous dirait pas d’évoluer un peu ? Faudrait que tout le monde soit initié à la musique orientale. Nous on est là avec nos tons, nos demi-tons, nos rythmes à deux temps, trois temps, quatre temps. C’est gentil ça a donné de beaux trucs, je dis pas le contraire, j’adore Beethoven moi aussi mais est-ce qu’on n’a pas quand même à gagner à aller voir ailleurs, maintenant qu’on a eu Beethoven ? Parce qu’il faut voir ce qu’ils font en Orient. Ne serait-ce qu’avec le rythme. Faut voir ce que c’est leurs combinaisons de deux temps et de trois temps, la complexité que ça donne tout de suite, déjà notre quatre temps pépère tu l’oublies, là-bas c’est le décalage qu’on recherche, le déséquilibre, tu frôles l’arythmie mais chaque fois quand même tu retombes juste, un-deux un-deux-trois un-deux, un-deux un-deux-trois un-deux, mais pour arriver à sept temps tu peux aussi décomposer en un-deux un-deux un-deux-trois, ou même en un-deux-trois un-deux un-deux, tout est possible du moment que tu arrives à sept, évidemment l’effet est différent, c’est pas du tout la même énergie, pas du tout la même ambiance », et pour nous montrer Farid fait sept sur son volant, sept encore d’une autre façon, Farid maintenant fait neuf, fait treize, fait dix-sept en chantant et à présent ne dit plus ni un ni deux ni trois, simplement ses lèvres sa langue fouettent, accélèrent prodigieusement sur certains temps, traînent au contraire sur d’autres et autour de nous il n’y a plus de volant plus d’autoroute plus rien, simplement les mains les lèvres de Farid.
mardi, 19h. Le pont de Normandie. Farid nous dépose à un péage où les employés guettent. Heureusement, la pancarte « Valenciennes » à peine dégainée, une berline s’arrête : c’est Franck, formateur expert en risques, 4.000 kilomètres en une semaine, yeux rougis de fatigue. Il est le premier avatar d’une troublante série que nous allons croiser le long de quatre pays (France, Belgique, Allemagne, Pologne) : le cadre dynamique, avec voiture de fonction (donc : grosse berline confortable et silencieuse), téléphone portable sur haut-parleur (appels au patron et aux associés : la voiture est un bureau), GPS (plus loin nous vitupérerons avec bonheur contre les GPS qui donnent le sentiment que de moins en moins de gens savent lire une carte ou un panneau), et bien sûr kilomètres par milliers.
Suivent Christian, qui a travaillé pour un sous-traitant de Renault en Roumanie, Véronique, qui vend du matériel de laboratoire aux hôpitaux et nous avance vers le Nord d’une centaine de kilomètres. Première vraie pause à l’aire de Péronne, en Picardie : il faut manger. Du pain, du jambon, des chips, un coca, un café : le total cumulé des dépenses grimpe d’un coup à 10,60 euros. C’était prévisible : les tarifs des stations-services sont prohibitifs. Ressortie sur le parking, et premiers doutes - l’auto-stoppeur est très superstitieux, se persuade vite que tel sourire va fonctionner, que telle posture le dessert. Une nouvelle berline nous tire d’affaire : Corentin et Virginie travaillent dans une petite société belge de « maintenance prédictive ». Virgine est fraîche, enjouée, jolie, etc. etc., s’amuse à nous vendre avec un enthousiasme d’office du tourisme le carnaval de Binche et ses cortèges de Gilles, refuse de croire que nous nous apprêtons à passer au large de Mons, où elle a fait ses études, sans prendre au moins le temps de visiter le centre-ville. « Attendez, je crois que vous n’avez pas très bien compris, sourit-elle comme nous demandons à descendre sur la prochaine aire pour continuer vers Aachen, en Allemagne. Parce que vous continuez de croire qu’on va vous laisser descendre avant d’arriver à Mons ? » Nous la quittons à regret, pour repartir avec Sebastian et Cath, couple d’anciens baroudeurs. On a passé notre première frontière.
Mardi, 21h30. Belgique, près de Namur. La nuit tombe, les voitures se font plus rares. Une Audi noire est garée près de la pompe, vitres fumées. Dedans, trois jeunes avec des canettes de coca. Nous ne leur montrons même pas notre panneau, pensant qu’ils n’auront pas de place. Mais la voiture s’arrête à notre hauteur : « Vous allez vers où ? – Vers l’Allemagne. – Montez, on va vous avancer. » Ils ne comprennent pourquoi on n’est pas allés vers eux... Ce n’est sans doute pas le moment pour RM de dévoiler sa théorie du délit de faciès à l’envers. Tuncay, Ramo et Hassan viennent de Charleroi et se rendent à Maastricht, à 130 kilomètres de là, côté Hollande, pour acheter du shit. Les trois sont touchants : dans leur grosse bagnole qui file à 180 kilomètres-heures, musique à fond, prêts à partager leur shit et leur coca, on pourrait croire des caïds, mais en nous entendant raconter notre périple en stop, direction la Biélorussie, ils ouvrent de grands yeux. SP évoque un précédent trajet en stop jusqu’en Turquie ; ils parlent du pays avec émotion et douceur. Ce n’est qu’à la fin, au moment de descendre et de prendre leur adresse (tous les convoyeurs vont recevoir ce numéro du Tigre avec notre récit), qu’ils nous expliquent qu’ils sont d’origine kurde.
Mardi, 22h15, environs de Liège. Nouvelle aire d’autoroute, nouvelle rencontre attachante : celle de Cédric qui, passés les préambules d’usage sur la coupe du monde de foot, glisse vers des sujets plus intimes : son désarroi depuis le départ de sa femme avec son meilleur ami (« On se dit toujours que ça n’arrive qu’aux autres, et puis un jour... ») ; son peu de hâte de rentrer chez lui tant que sa mère ne sera pas couchée, ce qui lui laisse tout le loisir de nous avancer de quelques kilomètres encore. Avec le gros Polonais moustachu qui nous prend ensuite, la conversation s’avère plus difficile : il ne parle pas anglais, on ne parle pas allemand. « Scholars ? » finit-il par marmonner. Je (RM) tente un : « No : écrivains, writers ». Tentative de mimer le geste d’écriture. Qui échoue. SP lui donne alors un indice qui deviendra sur-le-champ mythique : « Euh... Tolstoï ! Dostoïevski ! Gombrovicz ! » Le Polonais nous regarde interloqué. Pendant tout le trajet, SP, tout heureux de retrouver au fond de son cerveau ses rudiments de russe, s’obstinera à parler dans la langue de Staline, malgré l’air agacé de notre conducteur, qui finira par répondre au « Da svidania » d’adieu de SP un impatient : « I’m not russian ».
Mercredi, 0h08. Mine de rien, nous sommes passés en Allemagne : nous sommes près d’Aachen, i.e. Aix-la-Chapelle. Nous avons le sentiment d’une belle réussite (depuis Brest, environ 1000 kilomètres ont été avalés en une journée), terni par notre manque d’enthousiasme à l’idée d’une nuit sur le béton de la station-service. Pour nous changer les idées : des achats. Une carte d’Europe à 8,20 euros. Une cannette de bière fraîche (de la Tuborg) à 2,54 euros. Total cumulé de nos dépenses : 21,34 euros. Prise de possession d’un banc, saisie de la Tuborg, la main de SP s’approche de la capsule. Quand soudain : une camionnette blanche immatriculée dans la Seine-Saint-Denis ! SP va dire un mot au conducteur, à tout hasard. C’est oui : Hassan va à Berlin, à 600 kilomètres de là. Premiers récits d’Hassan, ses deux métiers, gardien de nuit sur des plateaux télé à la Plaine-Saint-Denis, livreur pour une société de transports à l’international. Dans l’immense coffre de sa camionnette, il y a deux moteurs d’avion : l’un à livrer à Rolls-Royce, l’autre à Hispano-Suiza. La Tuborg quant à elle est restée au fond du sac, notre pilote ayant déclaré qu’il ne buvait pas d’alcool. Hassan n’a pas de GPS et gère avec assurance son rapport au sommeil. Première pause vers quatre heures du matin. Nous dormons une heure, lui sur la banquette avant, nous à l’arrière, à côté des moteurs d’avion. À la reprise du trajet, je (RM) me refuse à rester à l’arrière pour dormir, impression d’être dans un cercueil roulant, SP se rendort tranquillement. Le soleil vient de se lever. L’autoroute allemande ressemble à toutes les autoroutes, monotone. On a traversé trois pays, et ce sentiment déjà, accru par la fatigue : on ne voit rien. Sentiment qui ira croissant, sans doute parce qu’on va bien trop vite, bien trop loin.
La vitesse « conseillée » est de 130 km/h, la fourgonnette d’Hassan monte tranquillement à 150-160 km/h. Hassan parle du Maroc, où il adore retourner mais où il n’imagine pas vivre, d’Argenteuil, où il habite maintenant avec sa femme et ses enfants, du destin de son père, embarqué avec des milliers d’autres jeunes maghrébins dans les années 1950 pour venir travailler en France. Une partie de l’argent qu’il gagne grâce à ses deux métiers sert à l’achat d’un appartement au Maroc, dans une résidence manifestement assez haut-de-gamme - drôle de destin, partagé entre deux pays, deux conditions. Les drapeaux de l’usine Rolls-Royce sont en vue. Hassan, généreux jusqu’au bout, poursuit au-delà pour nous déposer sur une aire.
Mercredi, 9 h10. Nous sommes à cinquante kilomètres de Berlin, le soleil cogne déjà. Passage aux toilettes de la station, payantes (1 euros pour les deux), formule café-tarte roborative (3,60 euros chacun), total cumulé des dépenses : 29,54 euros. SP est en pleine forme. Moi (RM), je n’ai quasiment pas dormi, et je suis au fond du trou : fièvre et mal de tête. Long moment d’échec à la station-service. Les routiers polonais ou biélorusses nous ignorent avec application. Les Allemands nous font tous croire qu’ils vont à Berlin. SP insiste pendant plus d’une heure en plein cagnard pendant que je tente de me reposer à l’ombre. Je finis par culpabiliser, me lève, prends la pancarte « Poznan » (à 300 kilomètres de là) et la brandis vers un break Audi, qui s’arrête. SP est ébahi. Nous voilà repartis avec Martin, un ingénieur allemand qui va assister à Poznan à une démonstration de boîtes de vitesses automobiles.
Mercredi, 14 heures. Arrivée en Pologne. Sapins. Sapins encore, serrés, sombres, seulement troués par endroits de clairières où se dressent des abris de chasse. De temps à autre seulement une bourgade : bureaux de change par dizaines, stations service, bars à putes signalés parfois par une poupée géante montrant ses cuisses. Après quelques kilomètres, des centaines de camions et quelques voitures sont à la queue-leu-leu : pourtant axe de communication majeur (Berlin-Moscou, en gros) l’autoroute s’arrête, inachevée encore (ouverture prévue pour l’Euro 2012). Sur une bretelle d’autoroute, juste avant Poznan, nous avosn à peine le temps de bricoler un panneau « Warschaw » que Greg s’arrête pour nous prendre, direction justement Varsovie. Nous l’écoutons s’entretenir longtemps en anglais avec son patron, appeler sa petite amie pour savoir s’il pleut à Varsovie, évoquer ses souvenirs de stop et d’Irlande où il a longtemps travaillé. Il nous parle de l’écriture (il a le projet d’écrire un roman, nous demande si c’est dur) et de l’amitié (« Vous croyez que c’est encore possible de se faire des amis après 30 ans ? »). On ne lui répond pas avec l’attention qu’il faudrait : au bout de deux jours de stop, la fatigue jouant, non seulement on est moins loquaces, mais l’enthousiasme des premières rencontres s’est un peu évanoui. Avant Varsovie, l’autoroute redevient une petite route : on entre dans une capitale comme si on passait par une bourgade le long d’une rocade. Greg nous dépose généreusement à la sortie de Varsovie, à l’est, direction Terespol (Pologne), la ville-frontière située juste en face de Brest (Biélorussie). Il nous reste donc environ 200 kilomètres pour atteindre notre but. Nous sommes confiants. Il fait presque nuit, une petite épicerie nous tend les bras. Pain et bière frais et bruns : nous dépensons un peu plus de 21 slotys, aussitôt arrondis, au vu du change, à 5 euros tout ronds. Total des dépenses cumulées : 34,54 euros.
Mercredi, 21h58. Postés à un feu rouge, nous brandissons notre pancarte « Terespol » en souriant aux véhicules arrêtés. Ça sent bon la pollution comme elle n’existe plus dans les pays riches avec leurs pots trop catalytiques. Mais quand le feu est vert, les bagnoles nous frôlent à toute allure. Nous nous demandons si persévérer ou non lorsque le réseau d’électricité de la ville décide pour nous : une panne de lampadaires plonge le secteur dans le noir. Je (RM) suis au bout du rouleau : je propose à SP d’aller dormir dans un petit hôtel voisin, repéré en passant. Surprise : dans ce quartier pourtant périphérique, c’est un quatre étoiles : l’hôtel Napoléon, rien que ça. Buis taillés à l’entrée, fauteuils Empire. Nous demandons le prix, en slotys, puis en euros, au cas où ce serait plus rentable : 70 ! Pas question. Cela nous ferait de toute façon dépasser notre plafond de 100 euros. À quelques centaines de mètres se dresse un hôtel Ibis, au milieu d’une zone en travaux. SP râle : donner de l’argent au groupe Accor, à l’autre bout de la Pologne ? J’argumente sans conviction. Arrivée à l’Ibis : bonne nouvelle, c’est complet.
C’est l’heure du choix. Dormir dans la rue ? Exploser définitivement le budget et nous payer une nuit au Napoléon ? Squatter discrètement le jardin de l’hôtel et filer de bonne heure avant d’être repérés ? Ces hésitations n’arrangent pas ma fièvre. Retour au Napoléon, où SP tente un ultime arrangement : obtenir de ne payer que 65 euros afin de ne pas dépasser le budget. Négociation guère favorisée par notre retour piteux ni par la difficulté à faire comprendre à la réceptionniste non anglophone que même si nous avons effectivement sur nous les 70 euros demandés, nous ne pouvons pas en dépenser plus de 65. La réceptionniste finit par nous faire un prix absurde : 68 euros.
Ne reste plus qu’un espoir : une erreur dans les comptes. Le temps de nous poser dans la chambre (en effet luxueuse : peignoir et pantoufles en coton-éponge, eaux gazeuzes), je refais le total : 102,54 euros. Découragement. Mais, miracle (lecteur nous jurons ici qu’il n’y a eu aucune triche !), au fond du sac de SP se trouve toujours la Tuborg achetée en Allemagne, 2,54 euros. Or bière non bue veut dire dépense non avenue : 100 euros, c’est gagné ! Et demain, il nous sera possible d’arriver à Brest sans dépasser le moindre euro : nous nous endormons sur cette certitude.
Jeudi, 10 heures. RM n’est pas du tout remis par la nuit. Tentatives toujours aussi médiocres au feu de la veille. Saut dans un bus qui nous dépose plus loin encore du centre-ville, à un carrefour qui n’a plus rien d’urbain. RM va se recoucher dans l’herbe, à l’ombre, tandis que je (SP) brandis toujours, en plein cagnard, ma pancarte « Terespol », parfois remplacée pour le plaisir par « Brest ». Quelques heures plus tard, je me penche vers RM : « J’ai trouvé la fin. Si aucune voiture ne nous prend, alors à un moment, clitch, on ouvre la bière : de 100 euros dépensés, on passe à 102,54 . Game over ! » C’était pas mal. Mais la vraie fin, c’est une vieille dame blonde qui nous la donne, en nous prenant à partie en anglais : « Vous n’avez aucune chance d’être pris, ici. Les gens pensent que vous êtes Ukrainiens ou Biélorusses, ils ont peur. Peu importe votre direction, la seule chose que vous devriez mettre sur votre panneau, c’est : ‘We are french !’ » Nous revendiquer Français, deux vieux antinationalistes comme nous ? Pas question. Notre voyage s’arrête donc là, à 199 maigres kilomètres du but. Avec la conviction que sans les 68 euros bêtement laissés à Napoléon, c’était Moscou qui nous tendait les bras.