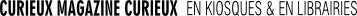


Dans l’arrière-boutique des ship managers
Dans l’arrière-boutique des anthropologues
« J’arrive à faire face à à peu près tout »
« Le respect de la diversité n’est pas une donnée française »
Une audience à la Cour nationale du droit d’asile
Grothendieck mon trésor (national)


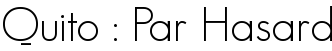
 |
|
|
Publié dans le
numéro 022 (Octobre 2012)
|
20 août 2012. Au 3 Hans Crescent, Londres, la façade d’un petit immeuble, un balcon minuscule : un drapeau aux couleurs de la Roumanie ou de la Colombie et un grand blond grise-mine qui pourrait faire la couverture de Challenges. L’homme, ancien archange de la liberté d’expression parce qu’il a diffusé des notes de service de l’armée américaine et du Secretary of State, annonce qu’il a reçu l’asile politique du gouvernement équatorien. Eh oui : la Roumanie, la Colombie et l’Équateur ont un drapeau aux mêmes couleurs. Qu’était donc devenu Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, depuis fin juin 2012, quand il était parti se cacher à l’ambassade d’Équateur, dans une pièce, nous avait-on dit, « sans fenêtres » ? Réponse : il apprenait à faire les nœuds de cravate pour son discours de dix minutes, au cours duquel il révèle au monde que son extradition vers la Suède n’est que la première étape d’une manipulation qui s’achèvera aux États-Unis, dans le couloir de la mort (sans fenêtres, là non plus). Qui peut sauver Assange ? L’ambassade d’Équateur n’a même pas de parking où il serait facile de le charger dans une voiture diplomatique avant de lui donner asile en France socialiste via le tunnel sous la Manche. Oh que j’eusse rêvé d’un pareil scénario. Mais non : je lis le journal. Metro, édition de Quito.
Quelques jours auparavant, j’étais encore à Bogotá. En Colombie, le département de production de documentaires pour la télévision se trouve dans la ciudad capital. Malgré les privilèges liés à l’appartenance à cette cellule moderne de propagande (équipes réduites, moyens financiers considérables, tournages à l’étranger), il est difficile de s’extraire de l’étrange atmosphère carcérale qui règne à Bogotá. Un sentiment dû à tous ces militaires armés qui patrouillent dans les rues, à ces agents de sécurité privés, à ces portiers à chaque entrée d’immeuble, à ces chiens dans les cours ; jusqu’aux voitures qui se verrouillent automatiquement avant même que vous n’ayez eu le temps de boucler votre ceinture. Pour entrer dans un immeuble, vous devez vous signaler au portier, annoncer quelle personne vous venez visiter et attendre que le portier lui-même joigne cette personne à l’interphone. Votre ami donne le feu vert au portier qui vous laisse ensuite passer. Même en tant que résident, il faut attendre que l’on déverrouille la porte de l’intérieur : on n’a pas la clé de son propre immeuble. Tout ceci étant une conséquence directe des divers conflits internes qui se sont intensifiés dans le pays au cours des années 1990.
Les dernières années avant sa mort en 1993, Pablo Escobar, bon vivant originaire de Medellín et pionnier du trafic de cocaïne à l’échelle internationale, en guerre avec son propre pays après avoir fait exécuter en 1989 trois des cinq prétendants aux élections présidentielles (dont Luis Carlos Gálan, le candidat socialiste qui était donné favori et qui était fortement engagé dans la guerre contre le narcotrafic), promettait un million de pesos colombiens [1] à qui tuerait un policier. Il est alors au sommet de son pouvoir : le pays est littéralement gangréné par son trafic, et Escobar se fait élire au Sénat. Au même moment, en 1991, plusieurs groupes armés, tel le M-19, déposent les armes suite à l’adoption de la nouvelle, et actuelle, Constitution. Dès lors, les Farc qui s’en tenaient jusque-là à théoriser dans la jungle et à effrayer les gens des campagnes, ne cesseront de gagner du terrain pendant près de dix ans, jusqu’à contrôler des régions entières. Face à la montée de ce terrorisme d’extrême gauche, des investisseurs privés et d’anciens militaires arment et forment ceux qui deviendront les membres des milices paramilitaires dont l’objectif avoué est de contenir et repousser l’expansion des Farc. Le triangle Farc, paramilitaires, armée, et leurs affrontements respectifs, donne au pays sa couleur de guerre civile depuis plusieurs décennies.
Donc, sans que cela n’ait rien de comparable à Gotham City, Bogotá peut éventuellement vous prendre à la gorge. Dans ces cas-là, je recommande d’aller taper dans son bas de laine et de se payer un billet pour la destination qui répondra au mieux au rapport suivant : rupture d’environnement/budget. En Amérique latine, c’est à la fois simple et compliqué. Simple, parce qu’il existe de nombreuses compagnies aériennes et de bus qui vous transporteront d’une capitale l’autre, d’une région l’autre sans trop dépenser. Compliqué, parce que même lorsque vous passez d’un pays à l’autre sur le continent (disons au sud de Panamá), il vous semble, à cause de la langue, de la musique et des empanadas qu’ils partagent, que chacun d’entre eux n’est qu’une version alternative de l’autre. Cela fait l’impression de voyager dans le temps plus que dans l’espace. Passer de Bogotá à Quito c’est — d’un point de vue superficiel — comme arriver dans une ville de Colombie où l’Histoire aurait voulu que le gouvernement soit de gauche et étouffe la guérilla, par exemple. Ou bien, voyant qu’à Quito la monnaie nationale est le dollar [2], on pourrait penser que les États-Unis ont définitivement et ouvertement assis leur domination sur ce continent. Mais ce sympathique sentiment d’uchronie est superficiel.
Du reste, lorsqu’on est à Quito (c’est tout ce que m’a permis mon bas de laine : un aller-retour en promotion pour l’une des capitales les plus proches), il est beaucoup plus agréable — et même pratique — de se promener qu’à Bogotá, même si aucun de mes amis colombiens ou équatoriens n’a été capable de me donner un mot correspondant à « se balader » ou « se promener ». Persuadé que la langue adhère aux pratiques de ceux qui la parlent, je me suis permis de m’en inquiéter, moi qui aime tant marcher (pour dire les choses platement). J’en profite tout de même pour errer sans but dans la ville, avec la Basílica del Voto Nacional comme vague point de repère, puisque c’est le bâtiment le plus visible, le plus en hauteur. Tout comme Bogotá, Quito est étroitement étalée entre deux flancs de la cordillère des Andes. Cette situation donne une forme toute particulière à ces deux agglomérations qui ressemblent à de longues coulées de bâtiments désordonnés et dénivelés ; en revanche, seule Quito se trouve près d’un un volcan en activité : le Pichincha (environ 4700 mètres). Sa dernière éruption remonte au 23 août 2006. Une petite dame me raconte que la ville a été recouverte de cendres chaudes, qui formèrent une pâte proche du ciment dès les premières pluies. Toute la ville était comme une réplique vivante et ludico-touristique de Pompéi. Deux heures après l’éruption, on pouvait acheter des T-shirts et des porte-clefs à l’effigie du volcan, avant même le premier masque pour se protéger des cendres.
Je replie le journal et repars m’aventurer dans la ville. Je m’essouffle vite (il m’a fallu deux semaines pour m’habituer à l’altitude en arrivant dans la cordillère la première fois). Je remarque qu’il est impossible de passer dans une rue sans qu’un des murs n’arbore l’un des deux graffitis suivants : « PCE » (Parti communiste d’Équateur) agrémenté d’une faucille et d’un marteau, ou « Correa + CNE = Fraude » (le Conseil national des élections organise et contrôle les scrutins, il sanctionne aussi les fraudes). La ville semble très nettement partagée entre les partisans du président Rafael Correa et de sa politique de gauche (qui va jusqu’à satisfaire les mouvements communistes) et ses détracteurs.
Après avoir passé la rue Guayaquil en travaux et les archives nationales, je m’assieds sur un banc au bord d’une grande place, c’est d’ailleurs son nom : La Plaza Grande. Je ne comprends pas immédiatement que le gouvernement va se montrer dans deux minutes au balcon d’en face, mais l’on sent bien à la vue de la garde présidentielle qu’il y a quelque chose d’inhabituel. On a brossé de petits quadrillages sur la croupe des chevaux. Des drapeaux Alianza País (le parti de Correa) flottent, et soudain, aussitôt ce défilé terminé, au micro un homme annonce, hystérique : « Et maintenant, Mesdames et Messieurs, le président-économiste, monsieur Rafael Correa ! » D’un seul geste la foule ôte son chapeau et crie son enthousiasme envers le président. La moitié du gouvernement est au balcon, et bien que je ne reconnaisse personne, j’essaie de repérer un politique ou deux d’après les descriptions qu’une mère fait à ses enfants à côté de moi. Rapidement le balcon se vide ; je traverse la cohue jusqu’aux premiers rangs sans trop de peine. Lorsque j’arrive au plus près du palais présidentiel, Correa est parti, et seuls restent deux ou trois journalistes qui prennent la foule en photo.
Devant les marches du palais, il y a deux groupes de militants. Des vieux avec des drapeaux rouges, faucille et marteau, T-shirts du Che, bérets du Che ; et des jeunes (enfin, entre trente et quarante ans), drapeaux vert fluo à l’effigie de Correa, des bandanas à l’image d’Assange et plusieurs pancartes et messages de soutien à ce dernier. Lorsque la voiture présidentielle passe devant la foule, les militants entonnent : « Correa amigo el pueblo está con tigo ! » L’émulation se fait sentir à mesure que les voitures officielles défilent. Les drapeaux rouges s’agitent et les chants reprennent de plus belle : « Los Ingleses no pasaran, con el pueblo se taparan ! » J’interroge une jeune indigène : « Vous êtes là pour Assange ? — Bien sûr, nous sommes tous venus ici pour soutenir la décision du président. » En fait de manifestation de soutien au cas Assange, c’est plus de Correa dont il est question dans cette histoire. C’est lui qui a la cote. C’est lui le líder charismatique [3]. D’ailleurs les militants poursuivent : « Yo no soy gringo, me voy con Chavez, con Correa y con Fidel ! » On se croirait dans un film de Chris Marker en moins prétentieux, en plus fou. Les chants redoublent. Correa, qui est déjà loin, n’entend rien. Dix minutes après le départ de la dernière voiture, la place commence à se vider. Pas un gobelet ne traînera derrière la foule ; une fois le paysage dégagé, des enfants arrivent pour cirer vos chaussures. C’est fini.
Je rejoins péniblement la basilique, puis me perds dans une brocante labyrinthique où l’on me prend justement pour un gringo et que je quitte rapidement. Sorti de là, je m’achète une glace à la mûre (choses très répandues dans la région : les glaces et les mûres) pour essayer de me rafraîchir un peu. Le vendeur me fait remarquer que j’aurais dû mettre un chapeau. Je marmonne quelque chose pour ne pas être impoli, et il ajoute que c’est la spécialité du pays. Il me montre le chapeau d’un passant. « Oui, un panama », je réponds un peu bêtement. « Ne me dites surtout pas ça. Vous savez que ce chapeau est équatorien ? C’est à cause des Français qui sont venus construire le canal, ils pensaient que c’était de là-bas, mais ce sont des vendeurs ambulants équatoriens qui les fabriquaient et leur vendaient. Et vous, vous êtes d’où ? »
[1] Environ 540 euros. Le salaire minimum actuel en Colombie est d’un demi-million de pesos, la moitié de ce que proposait Escobar il y a vingt ans.
[2] Le gouvernement équatorien a adopté le dollar américain comme monnaie nationale en 2000 afin de stabiliser l’économie suite à une grave crise en 1999.
[3] Surtout auprès des populations indiennes, depuis la reconnaissance des langues kichwa et shuar, inscrite dans la Constitution adoptée en 2008. Habituellement, les indigènes sont plutôt laissés pour compte et victimes de tous les préjugés. En Colombie il est fréquent d’entendre qu’« ils n’ont besoin de rien. Ils vivent comme ça ». Ce sont les gitans d’Amérique du Sud.